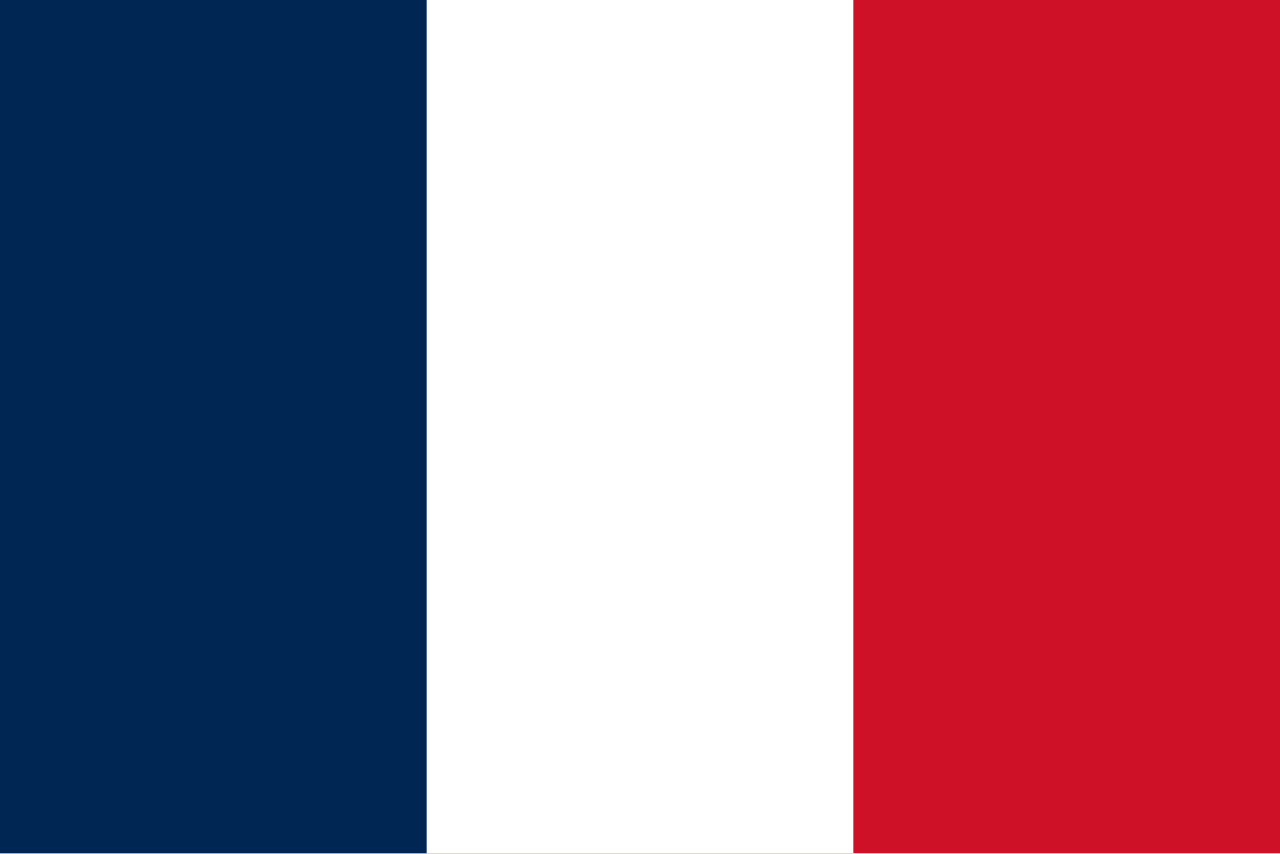


Sulubī! Bienvenue sur mon site consacré au gaulois. J'ai rassemblé une référence de vocabulaire, de grammaire, de déclinaisons, de conjugaisons, et diverses autres informations pour apprendre le gaulois. Je cherche à consolider ce que l'on sait de cette merveilleuse langue dans une ressource organisée qui rend chaque élément d'information facile à trouver.
Apprendre une langue dans son intégralité est une tâche de taille. Une façon de se familiariser avec une nouvelle langue est de traduire des éléments dans cette langue : de la prose, des poèmes, des paroles de chansons ou même vos pensées. Au début, cela signifie parcourir un dictionnaire et une grammaire, à la recherche de toutes les parties nécessaires jusqu'à ce que l'on mémorise les bases (ou au moins mémorise où trouver les informations !) et, espérons-le, devienne bilingue.
Pour faciliter ce processus, j'ai condensé une version de la langue gauloise reconstruite, à partir de différentes sources, dans cette référence, afin que toutes les informations soient facilement accessibles en un seul endroit dans un format de page Web à onglets. De plus, je vérifie des éléments de grammaire et de vocabulaire pour mieux refléter 1.) les inscriptions attestées, car je considère qu'elles sont l'indicateur le plus important de la forme et du style de la langue actuelle, et 2.) les reconstructions les plus récentes de l'ancêtre du gaulois, le proto-celtique.
Cette référence s'écartera donc inévitablement à certains égards des reconstructions d'autres passionnés du gaulois, car il y aura des caractéristiques et des mots que d'autres incluent que je rejette et vice versa. Reconstruire une langue signifie construire une langue, par conséquent, la plus vraie approximation moderne du gaulois équivaudra inévitablement à une conlang pleine de suppositions éclairées sur du matériel non attesté. La rareté du gaulois attesté signifie qu'il est important de reconnaître à quel point il est impressionnant qu'il existe des reconstructions préexistantes, et de reconnaître le travail que beaucoup ont fait pour redonner vie à cette merveilleuse langue. Comme toujours, j'apprécie les commentaires sur tout sujet où j'ai pu me tromper.
julie [αt] umop (đóτ) net.
sindā doliā Bituuegiās ni areberet briscās / ce site n'utilise pas de cookies.
Le gaulois était parlé dans l'Antiquité en Europe occidentale, notamment dans ce qui est aujourd'hui la France. C'est une langue celtique, et elle est donc apparentée à des langues comme l'irlandais et le gallois. Mais les langues celtiques modernes ont beaucoup changé au cours des millénaires, et le gaulois ressemble beaucoup à d'autres langues européennes anciennes comme le latin, le grec ancien, et le gothique. C'est une langue celtique continentale, avec le celtibère ainsi que quelques langues mal attestées comme le lépontique et le norique qui sont parfois considérées comme des dialectes du gaulois. Cela contraste avec le celtique insulaire qui comprend toutes les langues celtiques modernes, à l'exception des efforts de renaissance.
Le gaulois est classé comme une langue p-celtique, comme le gallois et le vieux brittonique, ce qui signifie que le son ancestral */kw/ a été changé en /p/ dans des mots comme prennon (arbre), à partir de l'ancien *kwresno-. Tacite a en effet noté que les langues des Gaulois et des Bretons de son époque « différaient peu », et de nombreux érudits modernes y voient une preuve de l'hypothèse d'un groupement gallo-brittonique. Par conséquent, les grammaires et lexiques gaulois disponibles sur Internet témoignent d'une influence considérable de l'hypothèse gallo-brittonique. D'autres notent que les langues goïdéliques et brittoniques partagent plusieurs caractéristiques grammaticales totalement absentes du gaulois, notamment la mutation consonantique, la fusion des prépositions avec les pronoms et l'ordre neutre des mots VSO, et émettent plutôt l'hypothèse d'un groupement celtique insulaire réunissant le goïdélique et le brittonique en un groupe distinct du gaulois. Il pourrait être impossible de déterminer quelle hypothèse est la bonne ; Les caractéristiques du celtique insulaire ont commencé à apparaître après l'invasion romaine de la Gaule, alors que le goïdélique (sous la forme du soi-disant irlandais primitif ou proto-goïdélique) et le brittonique commun (ancêtre du proto-britannique) étaient déjà des langues établies. Ceci indique que les changements du celtique insulaire ont été partagés par contact culturel et que le gaulois a été exclu en raison de sa romanisation. À l’inverse, le changement de son P-celtique est attesté en lépontique qui semble être une branche ancienne des langues celtiques. Par conséquent, la mutation phonétique *kw > p s'est probablement également propagée par contact culturel, au moins au gaulois, et peut-être ensuite au brittonique commun. En tout état de cause, il est clair que le gaulois, le brittonique et le goïdélique forment un groupe partageant des caractéristiques communes uniques, comme l'ajout de pronoms à la fin des verbes, et que ces trois langues se ressemblaient étroitement dans l'Antiquité classique. Dans cette référence, j'ai tenté d'omettre ou de supprimer les reconstructions de mots et de grammaire non attestés qui reflètent un biais gallo-brittonique.
La Gaule n'était pas une nation unique et unifiée, elle était plutôt constituée de nombreux petits royaumes ou micro-nations qui n'étaient pas sans rappeler la structure sociale celtique insulaire qui a probablement aussi donné naissance aux clans irlandais et écossais. L'absence d'identité nationale des Gaulois a fait qu'il n'y a jamais eu de dialecte gaulois standard, donc les reconstructions montrent parfois de multiples variantes de mots, correspondant probablement au langage de villages éloignés les uns des autres. Certains chercheurs actuels voudraient vous faire croire que la Gaule a été un ennemi monolithique de Rome pendant longtemps, avec Rome qui a fini par conquérir et anéantir les Gaulois, mais ce n'est tout simplement pas vrai. En réalité, Rome a administré la Gaule, enseignant les coutumes romaines et la langue latine aux Gaulois, produisant une culture hybride gallo-romaine. Les études soutiennent l'affirmation courante selon laquelle, loin d'être anéantis, les Gaulois forment une grande partie des ancêtres des peuples modernes des anciennes terres gauloises.
Et même si les Romains et les Celtes ont livré de nombreuses batailles, le manque d'unité de la Gaule et sa culture axée sur le guerrier ont donné lieu à de fréquents conflits internes entre les groupes gaulois voisins, et souvent, l'un des camps d'une escarmouche demandait l'aide des Romains. Rome s'est vite lassée de se laisser entraîner dans des querelles mesquines, et comme Jules César pensait pouvoir régler une partie de ses propres dettes monétaires si Rome annexait la Gaule, c'est ce qu'il a fait. Le chef gaulois Uercingetorīxs des Aruernī a unifié une grande partie de la Gaule et a opposé une vaillante opposition à César, mais même cette unification partielle est arrivée trop tard et les armées expertes et les ressources plus importantes de Rome ont finalement gagné. La langue gauloise a malheureusement disparu à la suite d'annexions, déclinant lentement sur des centaines d'années, au fur et à mesure que ses anciens locuteurs se tournaient vers le latin. Mais le fait que les locuteurs gaulois aient appris le latin a donné naissance à un dialecte unique, avec une saveur typiquement gauloise, qui allait devenir les langues gallo-romanes, dont le français.
Le gaulois n'est pas particulièrement bien attesté, il nous parvient principalement par le biais d'inscriptions, et les efforts pour les décoder ont historiquement été pleins d'incertitudes. Mais des reconstructions du gaulois ont été réalisées, en utilisant d'autres langues celtiques comme référence. Il existe de très bonnes leçons de gaulois sur le site Web du polythéisme gaulois, avec des liens vers une grammaire et un lexique. Il est impressionnant que les linguistes aient pu faire ces reconstructions, et le résultat est une version du gaulois qui peut être réanimée et parlée à nouveau.
Il existe quelques conventions variables concernant l'orthographe du gaulois.
Pour les usages de la lettre x, j'ai choisi d'écrire xs là où elle se prononce /xs/, comme dans dexsiuos et rīxs. La plupart des auteurs omettent le S, par exemple dexiuos, rīx, mais ce site Web conserve le S.
Certaines inscriptions originales semblent utiliser un I long, souvent transcrit par les chercheurs modernes sous la forme í, pour représenter deux sons différents : un I consonantique à côté d'un I voyelle, et un I voyelle longue, par exemple uediíū-mí. Certains sites de renaissance modernes optent pour une lettre J (uediju-mi) pour représenter le I consonantique, alors que même les anciens ne faisaient pas toujours la distinction entre les formes de la lettre I (uediiu-mi). J'ai choisi d'utiliser í ici pour représenter la consonne I à côté de la voyelle I, mais seulement par préférence, et il faut reconnaître qu'il y a encore des sections qui manquent d'accents aigus là où ils devraient être. Certains auteurs utilisent également W ou V pour la consonne U, et même K à la place de C, ce qui donne une orthographe plus robuste et sans ambiguïté mais n'est pas aussi fidèle aux inscriptions classiques.
Enfin, pour écrire la longueur des voyelles, certains auteurs préfèrent les accents circonflexes, par exemple mâros, tandis que d'autres préfèrent utiliser un macron, par exemple māros. J'utiliserai un macron sur tout ce site, mais encore une fois, c'est uniquement une question de préférence.
Mes sources d'information sur ce site incluent (principalement en anglais) :
La police gauloise sur ce site est ma propre création, Gaulish.ttf, sous license CC-BY-SA 4.0. Elle est basée sur le style manuscrit des écritures gauloises, lui-même dérivé de l'alphabet romain. J'ai aussi une autre version de la police qui est plus proche de la façon dont les anciens écrivaient, mais peut-être moins facilement lisible pour les yeux modernes, Galaties.ttf, ainsi qu'une version monospace, Gaulish_mono.ttf, toutes sous la même license CC-BY-SA.
Je ne maintiens plus de lexique de Galáthach hAthevíu, car j'ai choisi de me concentrer sur la langue naturelle des inscriptions attestées plutôt que sur les conlangs historiques alternatifs. Il faut reconnaître que même la reconstruction du "vrai" gaulois implique tellement de conjectures que la frontière entre cela et le conlanging est floue, donc si tout ce que vous voulez est quelque chose en rapport avec la Gaule qui sonne bien et qui est facile à apprendre, Galáthach est un excellent choix. Mais ce n'est pas le sujet de cette page. Toutes les informations sur Galáthach peuvent être trouvées sur son site officiel.

Iūlī Ialoloucā Uaidaniū* sīeꟈi nēbos sue-uercanton rīs iextibo ne saiturū • labarātor-sī Saxsoniextin etic adgninat nu Galatiíextin Galloiextin-c Rūsiíextin-c eti adgigne ammambi allobi Elladoiextin senin Gothoiextin-c Dīneiextin-c Nihoniextin-c Thaiíextin-c • Uaidaniū atrebāt en contrebī Foinicī sueltī poxtī tartī pennotrebī Arizoniās eni Ulatibi Comprinnābi Americiās con eiās tegoneꟈꟈamū eti duobin tegocattobi • eꟈꟈi-sī areseꟈ luxtū mārū rēmmanranniās etic inte remon uregeto sue rīmāticlārocerdū eti bituuegorīmāticlārocerdū
Julie L. Gagnon est une passionnée de langues autodidacte. Outre le gaulois, elle a étudié le grec ancien, le gothique, le russe, le navajo, le japonais, et le thaï, et sa langue maternelle est l'anglais. Julie habite sous le soleil brûlant de Phoenix, en Arizona, aux États-Unis, avec sa colocataire et ses deux chats. Elle conduit pour une plateforme majeure de covoiturage et a principalement travaillé comme développeuse de logiciels/web.
*Le nom Gagnon dérive du francique *waidanjan.
Le gaulois a un système de cas similaire à celui du latin et du grec ancien, et pas trop différent des systèmes de cas des langues modernes comme le finnois, le russe, l'allemand, etc. Bien que les cas nominaux nous soient inconnus en français, nous en avons des traces, notamment dans nos pronoms, comme le nominatif je, l'oblique me, et le possessif mon/ma. Les cas gaulois fonctionnent à peu près comme les cas de nos pronoms; ils sont simplement plus nombreux.
En général, c'est le cas pour le sujet d'un verbe, et le cas du prédicat avec le verbe pour "être". C'est aussi la forme du dictionnaire.
Utilisé pour s'adresser à l'auditeur.
Le cas de l'objet direct des verbes transitifs. Également utilisé avec certaines prépositions et certaines constructions ayant trait au mouvement vers.
Utilisé pour les possessifs et les partitifs (par exemple, « une quantité d'air », « une partie de la viande »). La plupart du temps, cela peut être considéré comme l'équivalent de ce que l'on appelle en français « de ». Il est également utilisé avec certaines prépositions. Dans les langues celtiques, le génitif a également une autre fonction, celle d'objet direct d'un nom verbal. Comme il n'y a pas d'infinitif (par exemple, « voir ») en celtique, il n'y a aucun moyen de dire directement, par exemple, « je veux voir les étoiles », donc vous le formuleriez plutôt comme « je veux l'acte de voir des étoiles » où « l'acte de voir » est un mot.
Il fonctionne comme un objet indirect, par exemple le destinataire d'un don. Il est également utilisé pour le sens de « avoir », car il n'existe pas de verbe pour ce sens. Au lieu de « j'ai », en gaulois, on dirait « pour moi il y a », etc. C'est en fait exactement la même formulation que dans le grec ancien.
À l'origine, ce cas, comme son nom l'indique, désignait l'instrument ou le moyen par lequel une action était réalisée. Au fil du temps, il a également acquis d'autres significations apparentées et, en proto-celtique, il a fusionné avec l'ancien ablatif, devenant l'un des cas les plus fréquemment utilisés. En gaulois, de nombreuses prépositions régissent l'instrumental, et avec les noms de lieu ou de temps, l'instrumental a même repris certaines des fonctions du cas locatif. C'est également le cas utilisé avec les comparatifs de noms.
Le locatif est à peu près ce à quoi il ressemble : des expressions d'être à ou dans, ou même près d'un moment ou d'un lieu, mais aussi d'être au sens figuré dans quelque chose d'intangible comme une situation. De ce dernier sens vient le sens de l'absolu locatif, qui est une construction qui signifie "A étant le cas, B s'est produit", impliquant que la condition a joué un rôle dans la cause ou la facilitation des événements de la proposition principale.
Notez que les 2 dernières phrases incluont un locatif de lieu ainsi qu'un locatif absolu.
Il n'existe pas beaucoup de documents écrits anciens en gaulois, car la culture était généralement opposée à l'écriture de la plupart des choses, donc les quelques inscriptions qui existent sont extrêmement précieuses pour l'étude de la langue. La plupart des inscriptions gauloises ont des significations controversées, en grande partie en raison d'une orthographe incohérente et d'une quasi-absence de ponctuation, aggravées dans de nombreux cas par l'écriture brouillonne et les lettres ambiguës que les Gaulois préféraient.
Here is a selection of inscriptions whose meanings are relatively clear, whose size makes them particularly important, or that demonstrate useful grammatical constructs. Where meanings are debated I may offer the most likely or best fitting interpretation, as well as interpretations of my own.
| L-35.1 |
|---|
| La Graufesenque à Millau, Aveyron |
| Le site où cette découverte a été faite présente également des traces de cuisson de poterie dans un grand four, probablement un lieu où de nombreux ouvriers traitaient simultanément d'importantes commandes de plusieurs clients. On y fabriquait peut-être aussi de beaux meubles ; cette note peut se rapporter au style préféré d'un client spécifique si *Aricanos est un nom, ou elle peut constituer une indication générale si « aricani » signifie « très beau » (de l'union des mots are + canis). |
|
|
| Le favori pour les bon meubles [est] d'être fait en trois parties égales. |
| L-44 |
|---|
| La Graufesenque |
| peculia rosiru ni adlo ni colliauto |
| Peculiā ro-sīrū ni adlon ni colliaunon |
| Peculiā ro-sīrū ni adlos ni colliaunos |
| Pour Pecula (ou Peculia ?) cela n'a été ni adapté ni satisfaisant pendant trop longtemps. |
| Il est probable que « colliauto » soit un imparfait du 3e singulier d'un verbe plutôt qu'un participe, donnant essentiellement le même sens. |
Il existe de nombreuses inscriptions dédiant un bâtiment ou une autre structure à une divinité. La plupart d'entre elles se présentent sous la forme « [personne] IEVRV/DEDE [nom de la divinité, datif] », IEVRV signifiant apparemment « dédié » et DEDE « donné ». Il serait trop répétitif de toutes les énumérer ici, mais la dédicace la plus intéressante connue, d'un point de vue linguistique, est peut-être la suivante :
| L-13 |
|---|
| Alise-Sainte-Reine, Côte-d’Or |
| Dédicace à la divinité vénérée par les habitants. Cette plaque a été retrouvée à l'emplacement d'un bâtiment assez grand, qui devait être construit pour les forgerons de la région, un lieu autrefois réputé pour le travail du métal. |
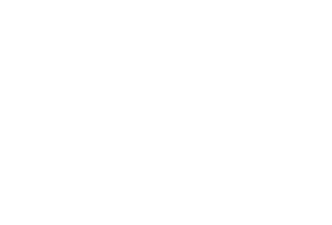 |
|
|
| Martialis, fils de Dannotalos, a dédié à Ucuetis cette salle de banquet avec les forgerons qui vénèrent Ucuetis à Alise. |
Les Gaulois aimaient boire et certains étaient probablement assez turbulents par moments. Ils produisaient une bière de blé forte qu'ils appelaient curmi, ils faisaient du commerce avec les Romains contre du vin, et certains villages produisaient peut-être aussi du whisky. L'existence d'un épithète ou d'un surnom signifiant « chercheur de bière » suggère que la consommation excessive d'alcool était mal vue. Ce surnom a cependant été utilisé comme prénom, impliquant une certaine acceptation de l'ivresse. Les inscriptions sur les récipients à boire reflétaient souvent la culture ivre des Gaulois.
| L-50 |
|---|
| Banassac, Lozère |
| Engraved on a drinking cup. |
|
|
| Je tiens les boissons du plus proche. |
| Note: neddamon (*neꟈꟈamon), gen. pl., peut signifier le plus proche physiquement, mais peut aussi avoir la connotation de ceux dont on est proche socialement. |
| L-51 |
|---|
| Banassac, Lozère |
| Publicité pour une boisson alcoolisée, probablement du whisky, fabriquée par les habitants du royaume des Rutènes, situé près de la frontière entre la Gaule celtique et la Gaule narbonnaise, dans l'actuelle Occitanie. De telles publicités étaient souvent gravées sur des objets tels que des verres pour tenter de stimuler la clientèle. |
|
|
| Goûtez à la liqueur des Rutēnī ; vous avez abondance dans la salle de banquet. |
| L'inscription montre la perte du -n final, ce qui semble avoir causé le changement de la terminaison accusative singulière des radicaux A de -in à -ā. |
| L-132 |
|---|
| Villa d’Ancy à Limé, Aisne |
| Inscrit sur un récipient destiné à contenir un liquide. |
| IBETIS VCIV · ANDECARI · BIIETE |
| ibetis au-ciū andecārī biíete |
| Buvez de ceci (et) soyez très aimables/joyeux. |
Le fusaïole semble avoir joué un rôle important dans la société gauloise, et plusieurs ont été conservés. Les inscriptions qu'il porte suggèrent qu'il était offert en cadeau, parfois à des membres de la famille ou à des amis proches, parfois à des partenaires sexuels, et les messages gravés vont du chaste à l'humour, voire à la franchement coquin. Au moins un fusaïole semble avoir été offert à la femme du petit-fils de l'acheteur en signe d'approbation (on peut lire AVE VIMPI), tandis qu'un autre pourrait signifier quelque chose comme « à une personne très laide » (on peut lire TIONOVIMPI MORVCIN, ce dernier mot ressemblant à une insulte française moderne), et un autre encore semble simplement indiquer « ton fuseau tend » (VEADIA TVA TENET). Il semble que la tradition voulait que les inscriptions sur fusaïole incluent généralement le mot VIMPI (uimpī, « belle ») quelque part dans le texte, quelques auteurs faisant preuve de créativité dans leur utilisation du mot, et qu'une fusaïole sans VIMPI indiquait probablement très clairement un manque d'intention romantique envers le destinataire.
| L-112 |
|---|
| zone de Autun, Saône-et-Loire |
|
| natā uimpī curmi dā |
| Belle fille, donne-moi de la bière. |
| L-117 |
|---|
| Autun, Saône-et-Loire |
|
| marcosiōr Māterniā |
| Je voudrais monter/avoir des relations sexuelles avec Materna. |
| Cet artefact a été découvert au même endroit que plusieurs autres inscriptions osées. On ignore si « Materna » est un nom ou si l'inscription reflète l'usage répandu de la juxtaposition des mots « mère » et « avoir des relations sexuelles » comme insulte, une habitude attestée dès le VIe siècle avant J.-C., lorsqu'Hipponax qualifiait l'un de ses adversaires de « μητροκοίτης ». La terminaison -IOR du verbe est similaire à celle d'un autre verbe attesté sur une tablette de malédiction, « nitixsintor », qui est probablement un optatif signifiant « qu'ils ne soient pas ensorcelés », issu du verbe *tiget « jeter un sort ». En extrapolant cela à la première personne, la morphologie optative correspond presque parfaitement à « marcosior ». Cette inscription semble alors signifier quelque chose comme : « j'aimerais avoir des relations avec [ta] figure maternelle/matrone ». De plus, comme le verbe signifie probablement littéralement « monter à cheval », l'inscription est très probablement un jeu de mots plausiblement contestable, cachant le message indélicat derrière une signification pudique telle que « j'irais à cheval avec la matrone ». |
| L-120 |
|---|
| Sens, Yonne |
| GENETTA IMI DAGA VIMPI |
| genetā imī dagā uimpī |
| Ma fille bonne et jolie. |
| L-119 |
|---|
| Saint-Révérien, Nièvre |
| MONI GNATHA GABI BVꟇꟇVTON IMON |
| monī gnatā gabī buꟈꟈuton īmon |
| Ma fille, prends mon (baiser? pénis?) |
| L-131 |
|---|
| Windisch, kn. Aargau |
|
|
|
| Que j'ai fait une promesse à Ixutios Drutos |
| Comme il n'existe pas de terminaison -ai connue pour les noms réguliers (il est peu probable que tocnā se décline comme benā), il semble probable que TOCNAI soit en réalité TOCNA I, correspondant peut-être à l'ancien *tocnin in, avec la perte du N final en gaulois tardif. Si tel est le cas, le sens littéral est « que j'ai fait une promesse dans Ixutios Drutos », peut-être traduit par « parce que j'ai fait une promesse à Ixutios Drutos ». |
| L-127 |
|---|
| Thiaucourt, Meurthe-et-Moselle |
| Inscrit sur une bague, apparemment pour empêcher les autres de convoiter celui qui la porte. |
| ADIA|NTVN|NENI|EXVE|RTIN|INAP|PISET|V |
| adiantun neni exsuertin in appisetū |
| Ni désir ni infidélité chez le spectateur. |
| Malgré les interprétations divergentes de cette inscription, sa formulation et son orthographe en rendent le sens très clair. « Désir » (adiantus < ad- + iantu-) et « infidélité » (exsuertis < ex- + uertis, « se détourner ») sont tous deux donnés à l'accusatif, suggérant peut-être que « que celui qui porte l'inscription n'inspire ni l'un ni l'autre à celui qui la regarde ». « Neni » est une variante de « nene » attestée, à la fois comme un seul mot comme ici, et comme « ne… ne », avec le sens de « ni une chose ni une autre ». « Appisetu » est soit un impératif (« qu'il/elle voie »), soit l'instrument d'appisetos participe masculin actif suffixé de appiset, « il/elle voir », s'accordant avec la préposition « in » pour signifier « en celui qui voit ». Une autre interprétation utilise exsuertinin comme nom complet, ce qui autoriserait l'impératif (« qu'il/elle ne voie ni désir ni infidélité ») et modifierait légèrement le sens du participe : « ni désir ni infidélité de la part de celui qui regarde ». Ce triple sens est probablement intentionnel. |
| Marcellus Empiricus (Burdigalensis), De Medicamentis |
|---|
| Bordeaux |
| A 4th-5th century writer living in roman Gaul reports this magic spell said to cure a sore throat. |
| exugri conexugri glion aisus scrisumio uelor exugri conexugri lau |
| exsugrī conexsugrī gliíon Aisu scrēꟈꟈū-mī-io uelōr exsugrī conexsugrī lau |
| Va-t'en, va-t'en, collant ! Aisus, je voudrais cracher. Va-t'en, va-t'en, lave (?). |
| En supposant que « lau » soit un impératif de lauet (laver, mouiller), on aurait pu s'attendre à *laue. |
| VC-1.2 |
|---|
| Vercelli, Piémont, Italie |
| 𐌅𐌊𐌉𐌔𐌉𐌏𐌔·𐌅𐌃𐌊𐌅𐌗𐌏𐌊𐌏𐌊 𐌑𐌅𐌗𐌄𐌃𐌄𐌊𐌏𐌔·𐌗𐌏ᛞ𐌏 𐌊𐌏𐌗𐌄·𐌅𐌗𐌏𐌑·𐌗𐌄𐌖𐌏𐌙 𐌗𐌏𐌑·𐌊𐌏𐌍𐌄𐌖 |
| Acisios Argantocomaterecos dōsioxt-i anton deuogdonion coneu |
| Acisios le trésorier a assigné la frontière commune entre les dieux et les hommes. |
|
Il s'agit d'un rare exemple d'inscription qui nous soit parvenue à la fois en gaulois et dans une langue plus compréhensible, en l'occurrence le latin. La partie latine de l'inscription se lit comme suit : « finis campo quem dedit Acisius argantocomaterecus comunem deis et hominibus ita uti lapides IIII statuti sunt », ce qui se traduit par : « limite du champ qu'Acisius Argantocomaterecus a donné en commun aux dieux et aux hommes, comme la manière dont les quatre pierres sont dressées » (source). L'existence d'un texte latin permet une interprétation fiable de l'essentiel du texte gaulois. |
Ces écrits composés de plusieurs phrases, et même parfois de plusieurs pages, sont extrêmement précieux pour l'étude des langues anciennes, car ils permettent de mieux comprendre la grammaire et la structure des phrases. Il n'existe rien de tel qu'un livre en gaulois, contrairement au vieil irlandais, au latin, au grec, au sanskrit et même au gothique, les longues inscriptions constituent donc les meilleures attestations gauloises dont nous disposons. Néanmoins, l'interprétation de ces documents est entourée d'un grand mystère. Voici une tentative d'interprétation aussi parcimonieuse que possible de deux de ces écrits les plus longs :
| L-93 |
|---|
| Châteaubleau, Seine-et-Marne |
| Une demande en mariage, Gaulois tardif (vers le IVe siècle de notre ère). |
|
|
|
Remarques :
|
| L-100 |
|---|
| Chamalières, Puy-de-Dôme |
| Une incantation ou defixio, écrite au nom de plusieurs hommes pour se protéger de la magie de leurs adversaires. La tablette suggère qu'une procédure judiciaire est en cours entre au moins l'un des hommes et une autre personne, qui aurait fait appel à plusieurs femmes pour jeter un sort sur les hommes. L'auteur désigne les adversaires par le terme ambigu anderon, qui pourrait signifier soit « jeunes femmes » (génitif pluriel de anderā), soit « infernal » (une forme de andernos). Bien que nous n'entendions malheureusement pas l'autre version de l'histoire, ce document témoigne d'une bataille de sorts entre deux groupes et pourrait offrir un aperçu des idiomes gaulois. |
|
|
|
Remarques :
|
Chaque langue a son propre accent, et il serait naïf de penser qu'une langue ancienne donnée avait un système simple à 5 ou 7 voyelles avec les mêmes qualités de voyelles et articulations consonantiques que n'importe quelle langue moderne parlée par l'auteur d'un manuel ou d'un site Web. Le gaulois a dû avoir de nombreux accents, puisqu'il s'agissait d'un continuum dialectal qui a changé au cours de plus d'un millénaire, donc toute tentative de reconstruire son accent ne peut au mieux aboutir qu'à un accent consensuel qui, espérons-le, ressemble autant au continuum que possible. En me basant sur les sons qui sont souvent interchangés dans le lexique, j'ai reconstruit la phonologie TENTATIVE suivante du gaulois. J'invite les autres à vérifier mon travail et à proposer leurs propres analyses et comparaisons. Tout ce qui se trouve dans cet onglet après cette phrase doit être considéré comme une supposition éclairée.
Dans cette section, j'utiliserai les symboles de l'alphabet phonétique international. Les symboles sont cliquables et diffuseront un enregistrement de leur son.
Un locuteur français moderne, en entendant le gaulois correctement parlé, remarquerait que les consonnes sont plus douces que ce à quoi il est habitué. Les occlusives sourdes p, t et c sonneraient plus légères et plus douces que dans la plupart des langues ; quel que soit leur son réel, les Romains les confondaient fréquemment avec b, d et g, comme dans Brittania de l'original Pritannī. En fait, même les Gaulois eux-mêmes confondaient d avec n, m avec u consonantique, et laissaient de côté le s entre les voyelles et, dans les dernières étapes de la langue, à la fin des mots, suggérant que tous ces sons étaient prononcés avec légèreté.
Les voyelles dans les syllabes accentuées étaient probablement prononcées clairement et distinctement, et présentaient également des contrastes qualitatifs, par exemple, le E long n'était pas simplement une version plus longue du E court. Mais les voyelles non accentuées auraient sonné plus confusément, et parfois même complètement disparu. Même la distinction entre voyelles courtes et longues n'était pas tant une question de longueur, puisque pendant la majeure partie de son histoire le gaulois avait un accent accentué, donc les voyelles accentuées auraient été prononcées longues de toute façon. Ainsi, une voyelle « longue » aurait simplement signifié une voyelle qui ne sonnait pas lâche et qui n'était pas marmonnée si elle n'était pas accentuée.
Bien qu'il soit facile de faire des suppositions éclairées sur la prononciation exacte d'une langue éteinte, et d'écrire ces suppositions en lettres API, cela ne rend toujours pas compte de l'accent distinctif de la langue. Il n'existe aucun enregistrement d'un locuteur gaulois L1, nous devons donc déduire à partir de langues apparentées et, dans une moindre mesure, de langues influencées par le gaulois, afin de comprendre à quoi cela aurait ressemblé. Sans entrer trop dans les détails, la réponse semble être: Un peu comme le gallois, mais plus léger en consonnes, avec un plus grand nombre de voyelles, et peut-être avec des sons [i:] et [u:] similaires au français, ce qui maintient la langue relativement haut par rapport à la plupart des langues pour ces deux voyelles.
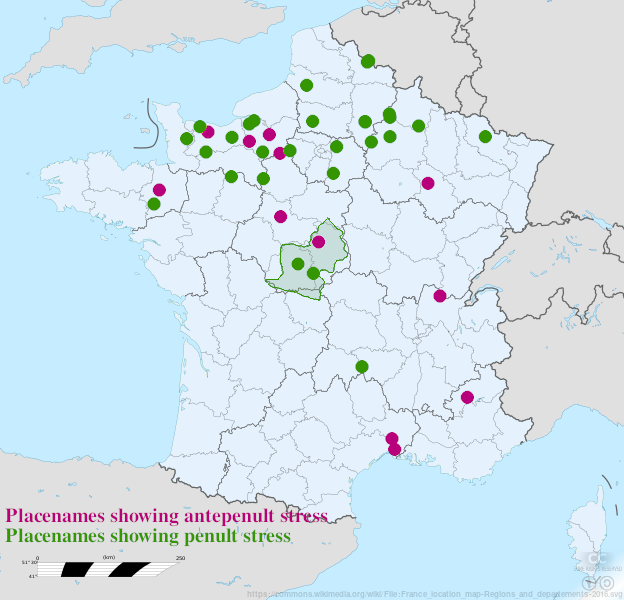
Au cours de la période où le gaulois était parlé à l'origine, l'accent a changé, passant apparemment d'un accent de hauteur à un accent d'accentuation. Il a également été fortement influencé par le latin et peut-être le grec. Il existe des preuves d'après les noms de lieux en France que le même mot gaulois pouvait être accentué de deux manières, même indépendamment de la longueur des voyelles, ce qui signifie que cela n'était pas dû à l'influence du latin. L'accentuation s'est également déplacée au-delà des frontières entre les composants des mots composés, en contradiction avec les reconstructions actuelles de la prononciation gauloise.
La carte à droite montre les emplacements approximatifs des noms de lieux montrant l'un ou l'autre modèle d'accentuation. Chaque accentuation antépénultième (points bordeaux) est inattendue, car elle enlève l'accent de la dernière partie d'un mot composé. Tous les noms de lieux indiqués devraient présenter un accent pénultième selon la compréhension consensuelle du gaulois. D'un autre côté, les accentuations pénultièmes (points verts) sont beaucoup plus courantes dans le nord, dans les régions plus proches de la Grande-Bretagne où le contact avec la langue brittonique aurait été le plus fort.
L'accent originel du gaulois ressemblait peut-être à l'accentuation pénultième du brittonique commun, ou à l'accentuation initiale de l'irlandais primitif. Le français moderne a perdu son accentuation environ mille ans après la vie des derniers locuteurs gaulois, donc il n'y a aucun indice à ce sujet. L'accentuation gauloise semble avoir été très variable selon les régions et avoir changé au fil du temps de sa propre volonté. Même aujourd'hui, pour le meilleur ou pour le pire, il n'y a pas de gaulois sans influences extérieures, en particulier latines. Par souci de cohérence, j'applique un ensemble de règles sur la façon dont l'accentuation est représentée dans cette référence.
Le gaulois a un accent tonique qui tombe généralement sur l'antépénultième (la troisième à partir de la dernière syllabe), comme en témoigne la forte tendance à supprimer les voyelles de la pénultième (l'avant-dernière syllabe), ce qui peut se produire que l'ultima (dernière syllabe) soit longue ou courte. Mais si le mot a une pénultième longue, alors c'est la pénultième qui a l'accent tonique. Et dans les noms composés, l'accent tonique tombe toujours dans la dernière partie du composé, par exemple catuuiros ( catus + uiros) qui est accentué sur le I. Mais si le dernier élément du composé n'a qu'une seule syllabe, alors cette dernière règle ne s'applique pas, et l'accent tombe là où il le ferait autrement, par exemple Uercingetorīxs ( uer- + cingetos + rīxs ), genitif Uercingetorīgos.
Les voyelles accentuées ont tendance à être prononcées plus longtemps que les voyelles non accentuées, mais il existe toujours une distinction entre les voyelles courtes et les voyelles longues. Par exemple, uiros means man but uīros means true.
Chaque voyelle pouvait être courte ou longue. Il se peut qu'il y ait toujours eu ou non une différence dans la longueur de la prononciation, mais parfois il y avait une différence dans la qualité de la voyelle.
La lettre A aurait ressemblé à quelque chose comme [ɑ] le plus souvent, bien que le A court non accentué soit probablement devenu [ə]. Mais lorsque le A court était directement suivi de L, M, N ou R, cela aurait pu ressembler à quelque chose de plus proche de [æ], par exemple dans le mot bannā, ou le mot entar, une variante de enter.
Le E court était probablement prononcé comme [ɛ], basé sur sa tendance à être échangé avec le A court et le I court. Dans les syllabes non accentuées, le E court peut avoir approché le son de [ə]. Longue Ē semble avoir été prononcé plus fermé, moins lâche, probablement comme [e:].
Le I court était souvent confondu avec le E court, surtout devant le M et le N. Il a peut-être été prononcé [ɪ], s'approchant même du son de [ɛ] avant M ou N, comme dans cinget et pimpe. Sinon, court et non accentué, j'ai peut-être parfois approché le son de [ə]. Le E court et le I court ne sont presque jamais confondus à la fin des mots, donc en position finale de mot, le I court a pu être prononcé [i]. Long Ī était presque certainement prononcé [i:] dans tous les environnements.
Le O court était souvent remplacé par le A court, par exemple locu, lacu, indiquant non seulement que le A court avait généralement un son soutenu mais aussi que le O court avait généralement un son ouvert, probablement quelque chose comme [ɔ]. Une exception était dans les terminaisons fléchies de mots comme les terminaisons très courantes -os et -on (ou -om), où le O court pouvait être prononcé de manière similaire à la voyelle en « comme ». Le long Ō, en revanche, est souvent confondu avec le long Ū, ce qui indique que le Ō avait probablement une prononciation très soutenue et arrondie comme [o:], comme dans la préposition dō, également attesté comme dū.
Le U court avait probablement un son laxiste comme [ʊ], car il échangeait parfois sa place avec le O court dans les terminaisons de mots, faisant même tomber les noms individuels librement dans l'une des deux déclinaisons. Le U long était presque certainement prononcé de manière très serrée et arrondie. Il y a un débat quant à savoir s'il était prononcé [u:] ou en façade comme dans « vu » : [y:]. On ne sait pas si le U français est dû à l'influence gauloise, mais cela semble peu probable. Le contact avec les langues germaniques telles que le francique peut expliquer l'existence de voyelles antérieures arrondies en français, et leur existence dans les langues germaniques est le résultat de l'assimilation d'une voyelle antérieure ou d'un glissement en Y dans la syllabe suivante, e.g. (PGmc.) fōtus/fōtjus > fōtus/fœ̄tjus > fōt/fœ̄t > fōt/fēt > (Eng.) foot/feet. Et si le gaulois avait ce son, il aurait probablement changé en [i:] avant l'extinction de la langue et de la modernité [y:] serait un développement ultérieur de toute façon.
Il est intéressant de noter que le grec ancien, une langue avec laquelle les Gaulois étaient en contact et qu'ils tenaient en haute estime, avait le son [y:], la prononciation du U gaulois a donc pu être influencée par cela. Cependant, l'erreur assez courante consistant à remplacer ō par ū (et vice versa) semble indiquer que si ū a déjà été prononcé [y:], il n'était prononcé de cette façon que dans certains mots et syllabes, et devait avoir conservé son ancienne [u:] valeur ailleurs. L'interprétation la plus parcimonieuse est que non, le gaulois n'avait pas le son [y:].
Les diphtongues gauloises sont ei, ai, oi, eu, au, et ou.
Ei était probablement prononcé de la même manière que ē, ou bien la diphtongue a fusionné avec la voyelle longue unique au fur et à mesure de l'évolution de la langue. De nombreux mots qui contiennent ei se trouvent également avec ē à sa place, par exemple leinos / lēnos.
Ai était probablement prononcé [aɪ] ou [əɪ], cependant, dans le développement ultérieur de la langue, sa prononciation a commencé à fusionner avec [ɛ]. Les diphtongues au et eu semblent avoir eu un son plus centralisé, probablement proche de [əʊ], et elles ont commencé à être confondues l'une avec l'autre et parfois avec la diphtongue ou.
Il n'y a pas beaucoup d'indices sur la prononciation de la diphtongue oi, il est donc raisonnable de supposer qu'elle avait une prononciation [oɪ], puisque cela semble être la façon la plus courante de prononcer oi dans de nombreuses langues. La diphtongue ou sonnait probablement comme le long O anglais, quelque part entre [oʊ] et [əʊ].
La lettre L a toujours été claire et toujours palatalisée comme elle l'est en français : [lʲ]. Même si la lettre L en français est également toujours claire et (presque) toujours palatalisée, il n'est pas certain que cette caractéristique vienne du gaulois ou ait été perdue et réintroduite plus tard à partir du francique, puisque le latin avait à la fois des sons L clairs et foncés et que la langue gallo-romane descendait du latin vulgaire, et que la prononciation exacte du L francique n'est pas connue. Mais en gaulois, le L se comporte comme une consonne palatale dans la façon dont il affecte les sons proches.
Les lettres P, T et C étaient prononcées très légèrement, presque inaudibles. Cela a amené les Romains à les confondre avec B, D, G dans les mots d'emprunt et les noms. En gaulois, ces sons étaient tenuis (sans aspiration, c'est-à-dire qu'aucun souffle d'air n'était libéré) et prononcés très doucement. La lettre C était également très sujette à la palatalisation lorsqu'elle était à côté d'une consonne palatale ou d'une voyelle antérieure (I ou E), comme dans melicā, une variante de, et peut-être une hypercorrection de, melatiā. La même alternance est observée dans le nom Diviciacus/Divitiacus, et il est probable que T ou C suivi de la consonne I produisent le même son, ou presque le même son. Parfois, les lettres CL dans un mot sont interchangeables avec TL, par exemple oclon avec la variante otlon, désignant également le même son ou des sons similaires.
Les lettres B, D et G représentaient également des sons légèrement prononcés, de sorte qu'ils alternaient parfois avec M et N. En fait, certains des changements de voyelles (voir ci-dessus) qui se produisaient avant M ou N se produisaient également parfois avant B, D ou G, comme ligā, variante de legā.
Les lettres M et N étaient également énoncées avec douceur, sonnant parfois presque comme un son W et un son R, respectivement.
La lettre S était également prononcée avec douceur, disparaissant souvent entre les voyelles ou à côté d'une consonne sonore. Il y avait probablement une qualité sonore [z] entre les sons sonores lorsqu'il ne disparaissait pas. Il ne semble pas y avoir beaucoup de preuves sur le fait que le S après O ou U était prononcé à l'envers, avec le bout de la langue près du palais dur et loin des dents, comme on pense qu'il l'était dans le latin classique. Cependant, les langues celtiques modernes ne le font pas, et le français non plus, donc le gallo-roman primitif ne le faisait probablement pas, bien qu'il soit une forme de latin, donc le gaulois ne le faisait probablement pas.
Les lettres I et U pouvaient fonctionner soit comme voyelles, soit comme consonnes; quand elles étaient des consonnes, elles sonnaient comme les sons /w/ et /j/ dans « oui » et « y'a ». En général, un I ou un U est une consonne s'il est immédiatement suivi d'une voyelle. (Parfois, un mot comme auiíī, "petit-fils [génitif]" apparaît et contourne cette règle.) Lorsqu'une consonne I suit une consonne dentale (comme T [t], D [d], S [s], ou N [n]), il semble avoir servi à palataliser la consonne en [tʲ], [dʲ], [sʲ], [nʲ], respectivement, peut-être sans que le I ait son propre son. Il en résulte que de nombreux mots avec une dentale suivie d'une consonne I ont une variante à laquelle manque la consonne I, comme dolā, dulā comme variantes de doliā.
Le gaulois s'écrit à différents endroits et à différentes époques, dans différentes écritures, notamment dans les alphabets latin, grec et lépontique. Bien que nous ignorions comment les anciens Gaulois désignaient les lettres individuellement, l'absence d'orthographe standardisée signifie qu'ils ne prenaient probablement pas la peine de se demander entre eux comment orthographier les mots. Néanmoins, il est raisonnable de supposer qu'ils utilisaient les noms originaux des lettres, les mêmes noms que ceux utilisés par les locuteurs de la langue dont l'alphabet était utilisé. Les prononciations suivantes sont une hypothèse éclairée :
Alphabet latin: A ā ; B bē ; C cē ; D dē ; ꟈ ꟈē / tau gallicon ; E ē ; F ef ; G gē ; H hā ; I ī ; Í ī māron ; K kā ; L el ; M em ; N en ; O ō ; P pē ; Q qū ; R er ; S es ; T tē ; U/V ū ; X ixs ; Y ī graicon ; Z zēta
Alphabet grec: Α alpa / alfa ; Β bēta ; Γ gamma ; Δ delta ; Ε ē ; Ζ zēta ; Η ēta ; Θ ꟈēta ; Ι iōta ; Κ kappa ; Λ labda ; Μ mū / mī ; Ν nū / nī ; Ξ xsē ; Ο ō meion ; Π pē ; Ρ rō ; Σ sigma ; Τ tau ; Υ ūpsilon / īpsilon ; Ψ psē ; Ω ō māron (Φ et Χ ne sont pas utilisés pour écrire le gaulois.)
| Singulier | Double | Pluriel | |
|---|---|---|---|
| Nom. | etn‑os | etn‑ō | etn‑ī, etn‑oi |
| Voc. | etn‑e | etn‑ō | etn‑ūs |
| Acc. | etn‑on | etn‑ō | etn‑ūs |
| Gen. | etn‑ī | etn‑ōs | etn‑on |
| Dat. | etn‑ū | etn‑obon | etn‑obo |
| Ins. | etn‑ū | etn‑obin | etn‑ūs/‑obi |
| Loc. | etn‑ē | etn‑ou | etn‑obi |
| Singulier | Pluriel | |
|---|---|---|
| Nom. | etn‑o | etn‑ī |
| Voc. | etn‑e | etn‑ū |
| Acc. | etn‑o | etn‑ū |
| Gen. | etn‑ī | etn‑o |
| Dat. | etn‑ū | etn‑obo |
| Ins. | etn‑ū | etn‑obi |
| Loc. | etn‑ē | etn‑obi |
Les noms animés à tige O se terminant par ‑ios partagent les mêmes terminaisons, par ex. anaganntios (quatrième mois de l'année), anaganntie, anaganntion, anaganntii, anaganntiū, etc.
| Singulier | Double | Pluriel | |
|---|---|---|---|
| NVA. | prenn‑on | prenn‑oi | prenn‑ā |
| Gen. | prenn‑ī | prenn‑ōs | prenn‑on |
| Dat. | prenn‑ū | prenn‑obon | prenn‑obo |
| Ins. | prenn‑ū | prenn‑obin | prenn‑ūs/‑obi |
| Loc. | prenn‑ē | prenn‑ou | prenn‑obi |
| Singulier | Pluriel | |
|---|---|---|
| NVA. | prenn‑o | prenn‑ā |
| Gen. | prenn‑ī | prenn‑o |
| Dat. | prenn‑ū | prenn‑obo |
| Ins. | prenn‑ū | prenn‑obi |
| Loc. | prenn‑ē | prenn‑obi |
Les noms neutres en O se terminant par ‑ion partagent les mêmes terminaisons, par exemple cridion (cœur), cridíī, cridiū, etc.
Les mots gaulois ont subi une modification phonétique au cours des dernières étapes de la langue, entraînant la disparition des sons N et S à la fin des mots. En conséquence, les déclinaisons des noms ont été quelque peu simplifiées durant cette période. Vous pouvez voir les différences entre les déclinaisons des noms gaulois anciens et tardifs en cliquant sur les boutons respectifs à droite.
| Singulier | Double | Pluriel | Singulier | Double | Pluriel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom. | abon‑ā | abon‑ī | abon‑ās | blēdnī | blēdnī | blēdniías |
| Voc. | abon‑a | abon‑ī | abon‑ās | blēdni | blēdnī | blēdniías |
| Acc. | abon‑in | abon‑ī | abon‑ās | blēdnīn | blēdnī | blēdniías |
| Gen. | abon‑iās | abon‑iōs, abon‑ious | abon‑ānon | blēdniās | blēdnious | blēdniānon |
| Dat. | abon‑ī | abon‑ābon | abon‑ābo | blēdníī | blēdniābon | blēdniābo |
| Ins. | abon‑ī, abon‑iā | abon‑ābin | abon‑ābi | blēdniā | blēdniābin | blēdniābi |
| Loc. | abon‑ī | abon‑ābin | abon‑ābi | blēdníī | blēdniābin | blēdniābi |
| Singulier | Pluriel | Singulier | Pluriel | |
|---|---|---|---|---|
| Nom. | abon‑ā | abon‑ā | blēdn‑ī | blēdn‑iía |
| Voc. | abon‑a | abon‑ā | blēdn‑ī | blēdn‑iía |
| Acc. | abon‑ā | abon‑ā | blēdn‑ī | blēdn‑iía |
| Gen. | abon‑iā | abon‑āno | blēdn‑iā | blēdn‑iāno |
| Dat. | abon‑ī | abon‑ābo | blēdn‑ī | blēdn‑iābo |
| Ins. | abon‑ī | abon‑ābi | blēdn‑ī | blēdn‑iābi |
| Loc. | abon‑ī | abon‑ābi | blēdn‑ī | blēdn‑iābi |
Le nom irrégulier benā, « femme », a la déclinaison suivante :
| Singulier | Double | Pluriel | |
|---|---|---|---|
| Nom. | benā | mnāi | mnās |
| Voc. | bena | mnāi | mnās |
| Acc. | benin, banin | mnāi | mnās |
| Gen. | mnās | baniōs, banious | mnānon |
| Dat. | mnāi | mnābon | mnābo |
| Ins. | mnāi | mnābin | mnābi |
| Loc. | mnāi | mnābin | mnābi |
| Singulier | Pluriel | |
|---|---|---|
| Nom. | benā | mnā |
| Voc. | benā | mnā |
| Acc. | benā | mnā |
| Gen. | mnā | mnāno |
| Dat. | mnāi | mnābo |
| Ins. | mnāi | mnābi |
| Loc. | mnāi | mnābi |
| Singulier | Double | Pluriel | |
|---|---|---|---|
| Nom. | elant‑is | elant‑ī | elant‑īs |
| Voc. | elant‑i | elant‑ī | elant‑īs |
| Acc. | elant‑in | elant‑ī | elant‑īs |
| Gen. | elant‑ēs | elant‑iōs, elant‑ious | elant‑iíon |
| Dat. | elant‑ē | elant‑ibon | elant‑ibo |
| Ins. | elant‑ī | elant‑ibin | elant‑ibi |
| Loc. | elant‑ī | elant‑ibin | elant‑ibi |
| Singulier | Pluriel | |
|---|---|---|
| Nom. | elant‑i | elant‑ī |
| Voc. | elant‑i | elant‑ī |
| Acc. | elant‑i | elant‑ī |
| Gen. | elant‑ē | elant‑iío |
| Dat. | elant‑ē | elant‑ibo |
| Ins. | elant‑ī | elant‑ibi |
| Loc. | elant‑ī | elant‑ibi |
| Singular | Dual | Plural | |
|---|---|---|---|
| NVA. | boud‑i | boud‑ī | boud‑iíā |
| Gen. | boud‑ēs | boud‑iíōs | boud‑iíon |
| Dat. | boud‑ē | boud‑ibon | boud‑ibo |
| Ins. | boud‑ī | boud‑ibin | boud‑ibi |
| Loc. | boud‑ī | boud‑ibin | boud‑ibi |
| Singulier | Pluriel | |
|---|---|---|
| NVA. | boud‑i | boud‑iíā |
| Gen. | boud‑ē | boud‑iío |
| Dat. | boud‑ē | boud‑ibo |
| Ins. | boud‑ī | boud‑ibi |
| Loc. | boud‑ī | boud‑ibi |
| Singulier | Double | Pluriel | |
|---|---|---|---|
| Nom. | brit‑us | brit‑ū | brit‑oues |
| Voc. | brit‑u | brit‑ū | brit‑oues |
| Acc. | brit‑un | brit‑ū | brit‑ūs |
| Gen. | brit‑ous, ‑ōs | brit‑ouō | brit‑uion |
| Dat. | brit‑ou, ‑ō | brit‑oubon | brit‑oubo |
| Ins. | brit‑ū | brit‑oubin | brit‑oubi |
| Loc. | brit‑ū | brit‑oubin | brit‑oubi |
| Singulier | Pluriel | |
|---|---|---|
| Nom. | brit‑u | brit‑oue |
| Voc. | brit‑u | brit‑oue |
| Acc. | brit‑u | brit‑ū |
| Gen. | brit‑ō | brit‑uio |
| Dat. | brit‑ō | brit‑ōbo |
| Ins. | brit‑ū | brit‑ōbi |
| Loc. | brit‑ū | brit‑ōbi |
| Singulier | Double | Pluriel | |
|---|---|---|---|
| NVA. | loc‑u | loc‑ū | loc‑uā |
| Gen. | loc‑ous, ‑ōs | loc‑ouō | loc‑uion |
| Dat. | loc‑ou, ‑ō | loc‑oubon | loc‑oubo |
| Ins. | loc‑ū | loc‑oubin | loc‑oubi |
| Loc. | loc‑ū | loc‑oubin | loc‑oubi |
| Singulier | Pluriel | |
|---|---|---|
| NVA. | loc‑u | loc‑uā |
| Gen. | loc‑ō | loc‑uio |
| Dat. | loc‑ō | loc‑ōbo |
| Ins. | loc‑ū | loc‑ōbi |
| Loc. | loc‑ū | loc‑ōbi |
Quelques noms en U‑déclinaison ont des racines diphtongues qui provoquent une déclinaison irrégulière, par exemple :
| Nom. | dīus (jour) | bous (vache) |
|---|---|---|
| Acc. | dīun | būn |
| Gen. | dīuos | bouos |
| Nom. | dīu (jour) | bou (vache) | cnou (noix) |
|---|---|---|---|
| Acc. | dīu | bū | cnou |
| Gen. | dīuo | bouo | cnouo |
| Singulier | Double | Pluriel | |
|---|---|---|---|
| Nom. | carans, carant‑s, caranꟈ | carant‑e | carant‑es |
| Voc. | carans, carant‑s, caranꟈ | carant‑e | carant‑es |
| Acc. | carant‑en | carant‑e | carant‑ās |
| Gen. | carant‑os | carant‑ou, carant‑ō | carant‑on |
| Dat. | carant‑ē | carant‑obon, carand‑bon | carant‑obo, carand‑bo |
| Ins. | carant‑ī | carant‑obin, carand‑bin | carant‑obi, carand‑bi |
| Loc. | carant‑ī | carant‑obin, carand‑bin | carant‑obi, carand‑bi |
| Singulier | Pluriel | |
|---|---|---|
| Nom. | carans | carant‑e |
| Voc. | carans | carant‑e |
| Acc. | carant‑e | carant‑ā |
| Gen. | carant‑o | carant‑o |
| Dat. | carant‑ē | carand‑bo |
| Ins. | carant‑ī | carand‑bi |
| Loc. | carant‑ī | carand‑bi |
Certains de ces noms ont des nominatifs irréguliers, tels que noxs, nuit, gén. noxtos, et moritexs, marin, gén. moritextos.
Un seul nom neutre à radical dentaire est connu :
| Singulier | Double | Pluriel | |
|---|---|---|---|
| NVA. | dant | dant‑e | dant‑ā |
| Gen. | dant‑os | dant‑ou, dant‑ō | dant‑on |
| Dat. | dant‑ē | dant‑obon, dand‑bon | dant‑obo, dand‑bo |
| Ins. | dant‑ī | dant‑obin, dand‑bin | dant‑obi, dand‑bi |
| Loc. | dant‑ī | dant‑obin, dand‑bin | dant‑obi, dand‑bi |
| Singulier | Pluriel | |
|---|---|---|
| NVA. | dant | dant‑ā |
| Gen. | dant‑o | dant‑o |
| Dat. | dant‑ē | dand‑bo |
| Ins. | dant‑ī | dand‑bi |
| Loc. | dant‑ī | dand‑bi |
| Singulier | Double | Pluriel | |
|---|---|---|---|
| Nom. | rīx‑s | rīg‑e | rīg‑es |
| Voc. | rīx‑s | rīg‑e | rīg‑es |
| Acc. | rīg‑en | rīg‑e | rīg‑ās |
| Gen. | rīg‑os | rīg‑ou, rīg‑ō | rīg‑on |
| Dat. | rīg‑ē | rīg‑(o)bon | rīg‑(o)bo |
| Ins. | rīg‑ī | rīg‑(o)bin | rīg‑(o)bi |
| Loc. | rīg‑ī | rīg‑(o)bin | rīg‑(o)bi |
| Singulier | Pluriel | |
|---|---|---|
| Nom. | rīx‑s | rīg‑e |
| Voc. | rīx‑s | rīg‑e |
| Acc. | rīg‑e | rīg‑ā |
| Gen. | rīg‑o | rīg‑o |
| Dat. | rīg‑ē | rīg‑(o)bo |
| Ins. | rīg‑ī | rīg‑(o)bi |
| Loc. | rīg‑ī | rīg‑(o)bi |
| Singulier | Double | Pluriel | |
|---|---|---|---|
| Nom. | cū | cun‑e | cun‑es |
| Voc. | cū | cun‑e | cun‑es |
| Acc. | cun‑en | cun‑e | cun‑ās |
| Gen. | cun‑os | cun‑ou, cun‑ō | cun‑on |
| Dat. | cun‑ē | cun‑obon | cun‑obo |
| Ins. | cun‑i | cun‑obin | cun‑obi |
| Loc. | cun‑i | cun‑obin | cun‑obi |
| Singulier | Pluriel | |
|---|---|---|
| Nom. | cū | cun‑e |
| Voc. | cū | cun‑e |
| Acc. | cun‑e | cun‑ā |
| Gen. | cun‑o | cun‑o |
| Dat. | cun‑ē | cun‑obo |
| Ins. | cun‑i | cun‑obi |
| Loc. | cun‑i | cun‑obi |
| Singulier | Double | Pluriel | |
|---|---|---|---|
| NVA. | anuan | anuan‑e | anuan‑ā |
| Gen. | anuēs* | anuan‑ou, anuan‑ō | anuan‑on |
| Dat. | anuan‑ē | anuam‑bon | anuam‑bo |
| Ins. | anuan‑i | anuam‑bin | anuam‑bi |
| Loc. | anuan‑i | anuam‑bin | anuam‑bi |
| Singulier | Pluriel | |
|---|---|---|
| NVA. | anuan | anuan‑ā |
| Gen. | anuē* | anuan‑o |
| Dat. | anuan‑ē | anuam‑bo |
| Ins. | anuan‑i | anuam‑bi |
| Loc. | anuan‑i | anuam‑bi |
*La terminaison génitive singulière ‑ēs descend du proto‑celtique *anmens, génitif de *anman.
Au moins un nom animé à radical N est reconstruit avec un nominatif en ‑an comme les neutres : abban (singe), décliné comme ceci :
| Singulier | Double | Pluriel | |
|---|---|---|---|
| Nom. | abban | abban‑e | abban‑es |
| Voc. | abban | abban‑e | abban‑es |
| Acc. | abban‑en | abban‑e | abban‑ās |
| Gen. | abban‑os | abban‑ou, abban‑ō | abban‑on |
| Dat. | abban‑ē | abbam‑bon | abbam‑bo |
| Ins. | abban‑i | abbam‑bin | abbam‑bi |
| Loc. | abban‑i | abbam‑bin | abbam‑bi |
| Singulier | Pluriel | |
|---|---|---|
| Nom. | abban | abban‑e |
| Voc. | abban | abban‑e |
| Acc. | abban‑e | abban‑ā |
| Gen. | abban‑o | abban‑o |
| Dat. | abban‑ē | abbam‑bo |
| Ins. | abban‑i | abbam‑bi |
| Loc. | abban‑i | abbam‑bi |
| Singulier | Double | Pluriel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom. | mātīr | suiūr | māter‑e | suior‑e | māter‑es | suior‑es |
| Voc. | mātīr | suiūr | māter‑e | suior‑e | māter‑es | suior‑es |
| Acc. | māter‑en | suior‑en | māter‑e | suior‑e | māter‑ās | suior‑ās |
| Gen. | mātr‑ōs | suior‑ōs | mātr‑ou, mātr‑ō | suior‑ou, suior‑ō | mātr‑on | suior‑on |
| Dat. | mātr‑ē | suior‑ē | mātr‑ebon | suior‑ebon | mātr‑ebo | suior‑ebo |
| Ins. | mātr‑i | suior‑i | mātr‑ebin | suior‑ebin | mātr‑ebi | suior‑ebi |
| Loc. | mātr‑i | suior‑i | mātr‑ebin | suior‑ebin | mātr‑ebi | suior‑ebi |
| Singulier | Pluriel | |||
|---|---|---|---|---|
| Nom. | mātīr | suiūr | māter‑e | suior‑e |
| Voc. | mātīr | suiūr | māter‑e | suior‑e |
| Acc. | māter‑e | suior‑e | māter‑ā | suior‑ā |
| Gen. | mātr‑ō | suior‑ō | mātr‑o | suior‑o |
| Dat. | mātr‑ē | suior‑ē | mātr‑ebo | suior‑ebo |
| Ins. | mātr‑i | suior‑i | mātr‑ebi | suior‑ebi |
| Loc. | mātr‑i | suior‑i | mātr‑ebi | suior‑ebi |
Les noms à radical R varient en fonction de la réduction de la racine dans les cas obliques. Noter la forme génitive du lexique aidera à savoir comment décliner les cas restants.
| Singulier | Double | Pluriel | |
|---|---|---|---|
| NVA. | nem‑os | nem‑ie | nem‑iā |
| Gen. | nem‑ios | nem‑iō | nem‑ion |
| Dat. | nem‑es | nem‑obon | nem‑obo |
| Ins. | nem‑es | nem‑obin | nem‑obi |
| Loc. | nem‑es | nem‑obin | nem‑obi |
| Singulier | Pluriel | |
|---|---|---|
| NVA. | nem‑o | nem‑iā |
| Gen. | nem‑io | nem‑io |
| Dat. | nem‑e | nem‑obo |
| Ins. | nem‑e | nem‑obi |
| Loc. | nem‑e | nem‑obi |
Lorsque les noms sont combinés, comme dans les noms personnels, le suffixe du radical combiné dépend de la déclinaison du nom :
| Déclinaison | Nom. | Gen. | Tige combinante |
|---|---|---|---|
| O | -os | -ī | -o- |
| A | -ā | -iās | -o- |
| I | -is | -ē | -i- |
| U | -us | -ous | -u- |
| Nasal | -ū | -nos | -o(n)- |
| Dental | -n(t)s, -nꟈ | -ntos | -nt(o)- |
| S | -os | -ios | -o- |
| Velar | -xs | -cos, -gos | -c(o)-, -g(o)- |
| R | -īr | -ros | -r(o)- |
| Singulier | Pluriel | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feminin | Masculin | Neutre | Feminin | Masculin | Neutre | |
| Nom. | mār‑ā | mār‑os | mār‑on | mār‑ās | mār‑ii, ‑oi | mār‑ā |
| Voc. | mār‑a | mār‑e | mār‑on | mār‑ās | mār‑ūs | mār‑ā |
| Acc. | mār‑in | mār‑on | mār‑on | mār‑ās | mār‑ūs | mār‑ā |
| Gen. | mār‑ās | mār‑ī | mār‑ī | mār‑ānon | mār‑on | mār‑on |
| Dat. | mār‑ī | mār‑ū | mār‑ū | mār‑ābo | mār‑obo | mār‑obo |
| Ins. | mār‑ī, mār‑iā | mār‑ū | mār‑ū | mār‑ābi | mār‑obi, ‑ūs | mār‑obi, ‑ūs |
| Loc. | mār‑ī | mār‑ē | mār‑ē | mār‑ābi | mār‑obi | mār‑obi |
(Comparatif irrégulier de litanos.)
| Singulier | Pluriel | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feminin | Masculin | Neutre | Feminin | Masculin | Neutre | |
| Nom. | let‑is | let‑is | let‑i | let‑ies | let‑ies | let‑iā |
| Voc. | let‑i | let‑i | let‑i | let‑ies | let‑ies | let‑iā |
| Acc. | let‑in | let‑in | let‑i | let‑īs | let‑īs | let‑iā |
| Gen. | let‑iās | let‑ēs | let‑ēs | let‑ion | let‑ion | let‑ion |
| Dat. | let‑ē | let‑ē | let‑ē | let‑ibo | let‑ibo | let‑ibo |
| Ins. | let‑ī | let‑ī | let‑ī | let‑ibi | let‑ibi | let‑ibi |
| Loc. | let‑ī | let‑ī | let‑ī | let‑ibi | let‑ibi | let‑ibi |
| Singulier | Pluriel | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feminin | Masculin | Neutre | Feminin | Masculin | Neutre | |
| Nom. | el‑us | el‑us | el‑u | el‑iās | el‑iies | el‑iā |
| Voc. | el‑u | el‑u | el‑u | el‑iās | el‑iies | el‑iā |
| Acc. | el‑uin | el‑un | el‑u | el‑iās | el‑ūs | el‑iā |
| Gen. | el‑uās | el‑ous, el‑ōs | el‑ous, el‑ōs | el‑uion | el‑uion | el‑uion |
| Dat. | el‑uī | el‑ou, el‑ō | el‑ou, el‑ō | el‑uābo | el‑uibo | el‑uibo |
| Ins. | el‑uī | el‑ū | el‑ū | el‑uābi | el‑uibi | el‑uibi |
| Loc. | el‑uī | el‑ū | el‑ū | el‑uābi | el‑uibi | el‑uibi |
| Singulier | Pluriel | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feminin | Masculin | Neutre | Feminin | Masculin | Neutre | |
| Nom. | trūx‑s | trūx‑s | trūx‑s, trūc | trūc‑es | trūc‑es | trūc‑ā |
| Voc. | trūx‑s, trūc | trūx‑s, trūc | trūx‑s, trūc | trūc‑es | trūc‑es | trūc‑ā |
| Acc. | trūc‑en | trūc‑en | trūx‑s, trūc | trūc‑ās | trūc‑ās | trūc‑ā |
| Gen. | trūc‑os | trūc‑os | trūc‑os | trūc‑on | trūc‑on | trūc‑on |
| Dat. | trūc‑ē | trūc‑ē | trūc‑ē | trūc‑obo | trūc‑obo | trūc‑obo |
| Ins. | trūc‑ī | trūc‑ī | trūc‑ī | trūc‑obi | trūc‑obi | trūc‑obi |
| Loc. | trūc‑ī | trūc‑ī | trūc‑ī | trūc‑obi | trūc‑obi | trūc‑obi |
Les degrés de comparaison pour les adjectifs réguliers sont le comparatif et le superlatif, ainsi qu'un degré emphatique qui est apparenté à un préfixe équatif en celtique insulaire.
Il n'existe aucune preuve de l'existence d'un équatif en gaulois. Pour la signification de l'équatif, utilisez dūcī +acc., par exemple cauaros eꟈꟈi māros dūcī moniíon "le géant est aussi grand qu'une montagne." Pour dire qu'une personne ou une chose est semblable à une autre, utilisez samalos avec le datif de l'entité à laquelle on la compare, par exemple eꟈꟈi-sī mātrē samalā « elle est comme sa mère ».
| Degré | Préfixe | Suffixe | Exemple | Glose |
|---|---|---|---|---|
| Positif | - | - | axsros | de haut taille |
| Comparatif | - | -iūs | axsriūs | de plus haut taille de; dássez haut taille |
| Superlatif | - | -isamos | axsrisamos | du plus haut taille; de tres haut taille |
| Emphatique | com- | - | conaxsros | de tres haut taille |
Le degré comparatif en -iūs s'est vu attribuer une déclinaison unique (voir Iextis Galation), cependant selon Wiktionary, "No gender/number/case inflection of comparative adjectives is attested in Celtic," (aucune inflexion de genre/nombre/cas des adjectifs comparatifs n'est attestée en celtique.) Par conséquent, il est possible que le suffixe -iūs soit indéclinable en gaulois. Cependant, la simplification des terminaisons comparatives en une forme indéclinable peut être le résultat du fait que dans le goïdélique primitif, le comparatif n'était utilisé que de manière prédicative, jamais de manière attributive, et qu'il aurait donc rarement été utilisé dans d'autres cas que le nominatif. Si c'est la cause, alors la réduction et la perte de la déclinaison comparative pourraient être une innovation goïdélique qui s'est propagée au brittonique dans le cadre des développements celtiques insulaires partagés, laissant ainsi le gaulois intact. Dans cette hypothèse, la déclinaison comparative suivante peut être reconstruite pour le gaulois sur la base de ses reflets du proto-celtique:
| Masc./Fem. | Neu. | |||
|---|---|---|---|---|
| Singulier | Pluriel | Singulier | Pluriel | |
| Nom./Voc. | axsríūs | axsríoses | axsris | axsrisā |
| Acc. | axsríosan | axsríosās | axsris | axsrisā |
| Gen. | axsrisos | axsrison | axsrisos | axsrison |
| Dat. | axsrisē | axsrisbo | axsrisē | axsrisbo |
| Ins. | axsrisī | axsrisbi | axsrisī | axsrisbi |
Le préfixe emphatique com- peut devenir con- ou co- devant certains sons pour faciliter la prononciation. Avant l, il devient cob- comme dans cobletos < com- + *letos, cobrūnos < com- + rūnos.
Certains adjectifs ont des gradations irrégulières:
| Positif | Glose | Comparatif | Superlatif | Emphatique |
|---|---|---|---|---|
| adgoꟈꟈus | proche | neꟈꟈiūs | neꟈꟈamos | - |
| cintus | premier | cintiūs | cintusmos | - |
| dagos | bon | uellos | dagisamos | condagos |
| drucos | mauvais | uaxtos | uaxtamos | condrucos |
| elus | beaucoup | lēiūs | - | comantis |
| īꟈꟈelos | bas | īꟈꟈeliūs | īꟈꟈamos | conīꟈꟈelos |
| iouincos | jeune | iouiūs | iouamos | coniouincos |
| lagus | petit | lagiūs | lagisamos | coblagus |
| litanos | large | letis | letisamos | coblitos |
| māros | grand | māiūs | maisamos | comantis |
| sīros | long | sēios | sēiamos | cosīros |
| trēnos | puissant | trexsios | trexsamos | contrēnos |
| ūxsellos | haut | ūxsios | ūxsamos | conūxsellos |
Règles de déclinaison:
L'emphatique peut être utilisé pour signifier « tellement », « si ».
mīeꟈi coblitā tegiā
J'ai une maison tellement grande.
cauaros eꟈꟈi comantis
Le géant est si grand.
Les comparatifs sont utilisés avec l'instrumental de l'entité comparée. En soi, un comparatif signifie « tellement ».
tuos mapos eꟈꟈi iouiūs mapū īmos
Votre fils est plus jeune que le mien.
tīeꟈi mapos iouiūs
Vous avez un fils assez jeune.
Les superlatifs prennent enter + instrumental pluriel de la classe ou du groupe dans lequel l'entité possède le plus de quelque qualité. Ici aussi, le superlatif seul sans classe ni groupe signifie "très", cf. des usages tels que "une peinture des plus exquises" ou "un mystère des plus curieux".
ei-tū cū dagisamos enter pāpobo cumbo in mages !
Tu es le meilleur chien du parc!
ei-tū cū dagisamos
Tu es un très bon chien!
Les adjectifs peuvent être rendus adverbiaux de deux manières:
Exemples:
cingetes inte mārogalon ambi-ueuonar.
cingetes mārogalū ambi-ueuonar.
Les soldats se sont battus courageusement.
| Première | Deuxième | |||
|---|---|---|---|---|
| Singulier | Pluriel | Singulier | Pluriel | |
| Nom. | mī | snīs | tū | suīs |
| Acc. | me | snīs | te | suīs |
| Gen. | mon* | anson | ton* | sueson |
| Dat. | mei | amē | tei | umē |
| Ins. | me | anse | te | ume |
| Loc. | me | anse | te | ume |
*Les pronoms possessifs sont bien plus couramment utilisés que les génitifs, qui se déclinent comme des adjectifs. L'adjectif possessif à la première personne est irrégulier. Ils sont attestés par mon, moni, imi, imon, et tva. Les formes mon et moni apparaissent avant le nom ; imon et imi apparaissent après, comme le fait tva, ce qui peut indiquer que *tuos, tuā, *tuon, contrairement à *mos, monī, mon, n'a pas de forme **ītos distincte qui suit le nom.
En ce qui concerne leurs déclinaisons, mos, mon se déclinent probablement comme un adjectif O/A, mais avec le radical irrégulier mon- au génitif et aux cas obliques pour éviter toute confusion avec d'autres pronoms : monī, monū, monū, monē; monon, monbo, monbi, monbi pas **mī, **mū, **mē, etc. La forme féminine monī se décline probablement comme blēdnī. La déclinaison de īmos, īmī, īmon est probablement entièrement régulière et parallèle à celle de uimpos, uimpī, uimpon. Pour tuos, tuā, tuon la déclinaison peut être entièrement régulière bien que le f. acc. sg. soit susceptible d'être tuan au lieu de **tuin, par analogie avec sian. Bien que cette déclinaison soit quelque peu irrégulière, elle évite des collisions avec des mots importants sans rapport : d'une part, l'utilisation de monī, irrégulier, au lieu de l'attendu **mā, évite toute confusion avec le mot pour « si » ; deuxièmement, l'utilisation de tuon au lieu de **ton évite toute confusion avec le mot pour « alors », et enfin, l'absence de **ītos fait que ses formes déclinées ne seraient pas confondues avec les mots pour « grain » et « manger ».
Sans surprise, les Gaulois semblent avoir à un moment donné abandonné ce système complexe de déclinaison, probablement en conservant seulement m./n. mon / ton et f. monī / tuā, et peut-être en utilisant toujours la première paire avant une voyelle initiale, comme nous le faisons encore en français moderne (par exemple mon amie, ton épouse). Une ou deux inscriptions semblent également avoir un préfixe possessif to- pour la deuxième personne, indiquant peut-être une simplification supplémentaire du système possessif.
Bien que les langues goïdéliques et brittoniques présentent des réflexes du proto-celtique *mene (mon, mien) qui se transforme en *mowe sous l'influence de *towe (ton, tien), il n'existe aucune preuve de l'existence des formes équivalentes **mou et **tou en gaulois.
Le génitif 1er pluriel est peut-être attesté comme onson (Chamalières, L-100), cependant, le sens de cette partie du texte est incertain et le texte « onson » semble dépasser une limite de mot. La forme prédite par les reflets proto-celtiques des reconstructions indo-européennes est *anson, c'est donc la forme donnée ici pour le moment.
Les réfléchis du 1er et du 2ème pronom sont formés par :
Le pronom oinānos, -ā, -on, , décliné en adjectif O/A, a un sens emphatique, comme dans « j'ai moi-même [fait la chose] ».
| Singulier | Double | Pluriel | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fem. | Masc. | Neu. | Fem. | Masc. | Neu. | ||
| Nom. | eiā | is | id | ī | eias | eis | ī |
| Acc. | sian | íin | id | ī | sies | eiūs | ī |
| Gen. | eiās | eio | eio | eiō | eianon | eion | eion |
| Dat. | eíī | eiū | eiū | eiobon | eiābo | eiobo | eiobo |
| Ins. | eíī | eiū | eiū | eiobin | eiābi | eiobi | eiobi |
| Loc. | eíī | eiū | eiū | eiobon | eiābo | eiobo | eiobo |
Le troisième pronom réfléchi est formé en préfixant sue-: sueíin lui-même, suesian elle-même, etc. Le préfixe sue- peut également être préfixé à un nom possédé, e.g. suetegiā ma/ta/sa/notre/votre/leur (propre) maison.
Le pronom emphatique oinānos peut également être utilisé à la troisième personne.
Les formes obliques de ceilios (compagnon, partenaire) remplace le sens de « l'un l'autre », par exemple appisomos-nīs ceiliūs « nous nous voyons. » Des variantes de cet usage se retrouvent en irlandais, en gaélique écossais et en gallois.
Un ensemble de démonstratifs simples, signifiant probablement « ceci »/« cela »/« le susdit », est attesté, principalement sous les formes se et so, et peut-être sana. On ignore si se représente une flexion spécifique, une forme indéclinable, ou un synonyme de so.
| Singulier | Pluriel | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| F | M | N | F | M | N | |
| Nom. | sā | sos | so | sās | soi | sanā |
| Acc. | sān | son | so | sās | sūs | sanā |
| Gen. | soiās | soio | soio | sānon | soion | soion |
| Dat. | soíī | soiū | soiū | sābo | soibo | soibo |
| Ins. | soiā | somū | somū | sābi | soibi | soibi |
| Loc. | soíī | sē | sē | sābi | soibi | soibi |
Les démonstratifs proximaux (c'est-à-dire ceci, ces) sont attestés en gaulois par sendi, sinde, et indas, ainsi que par le préfixe sin- dans sindiu signifiant « aujourd'hui », littéralement « ce jour-là ». L'ensemble suivant de démonstratifs proximaux peut être reconstitué :
| Singulier | Pluriel | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| F | M | N | F | M | N | |
| Nom. | sindā | sindos | sindon | sindās | sindī | sindā |
| Acc. | sindin | sindon | sindon | sindās | sindūs | sindā |
| Gen. | sindās | sindī | sindī | sindānon | sindon | sindon |
| Dat. | sindī | sindū | sindū | sindābo | sindobo | sindobo |
| Instr. | sindī | sindū | sindū | sindābi | sindobi | sindobi |
| Loc. | sindī | sindē | sindē | sindābi | sindobi | sindobi |
Il existe des composés de sindos avec des noms, où le démonstratif devient un préfixe sin- signifiant « ceci », comme dans sindīū « aujourd'hui », sinbāregū « ce matin », sinnoxti « ce soir ».
Des traces d'un autre ensemble de démonstratifs, signifiant peut-être « que, ceux-là », sont attestées comme sondios, sondiobi, et onda.
| Singulier | Pluriel | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| F | M | N | F | M | N | |
| Nom. | sondiā | sondios | sondion | sondiās | sondī | sondiā |
| Acc. | sondīn | sondion | sondion | sondiās | sondiūs | sondiā |
| Gen. | sondiās | sondī | sondī | sondiānon | sondion | sondion |
| Dat. | sondī | sondiū | sondiū | sondiābo | sondiobo | sondiobo |
| Instr. | sondī | sondiū | sondiū | sondiābi | sondiobi | sondiobi |
| Loc. | sondī | sondiē | sondiē | sondiābi | sondiobi | sondiobi |
Au moins un démonstratif emphatique sosin est attesté dans des dédicaces de la forme « untel a dédié CE monument à [nom de la divinité] ». La forme sosio est attestée et pourrait être un synonyme ou une autre forme de ce même pronom, ou une conjonction formée de sos et du suffixe relatif -io.
Ceux-ci déclinent comme des adjectifs O/A.
| Indéfini | Négatif | Interrogatif | Relatif | Démonstratif | Identitatif | Alternatif | Universel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Animé | nepos quelqu'un | ne donios aucun personne | pē? qui? | io(n) qui | sos ceci, cela | somos le même | allos un autre | ollos, pāpos tous, chaque |
| Inanimé | nepon quelque chose | ne nepon rien | pid? quoi? | io quoi | so, id ceci, cela | somon le même | allon un autre | ollon, pāpon tous, chaque |
| Locatif | nepū inedū quelque part | ne inedū nulle part | pid inedū ? où? | pid inedū où | ciē
ici, endo là |
somū inedū au même endroit | allū inedū autre part | ollū inedū partout |
| Source | au nepū inedū de quelque part | au ne inedū de nulle part | panā ? d'où? | panā d'où | au endo à partir de là | au somū inedū du même endroit | au allū inedū d'ailleurs | au ollū inedū de partout |
| Temporel | ammambi, uextobi parfois | ne ammani, ne uextū jamais | ponc ? quand? | ponc quand | ton alors | somū ammani en même temps | allū ammani autre fois | ollū ammani tousjour |
| Qualitatif | nepon cenetlon une sorte | ne cenetlon aucun, rien de tel | pid cenetlon ? quelle sorte ? | cenetlon io du type qui | ixsos tel | somon cenetlon le même type | allon cenetlon autre type | ollon cenetlon toutes sortes |
| Quantitatif | inte nepon quelque peu | ne nepos aucun montant | peti ? combien? | peti combien, autant | dūcī tellement | dūcī autant | allon imbeton un montant différent | ollos tous, entier |
| Manière | inte nepon de quelque manière | ne cammanū pas de manière | pō ? comment? | pō comment | suā ainsi | inte somon de la même façon | inte allon une autre façon | inte ollon de toutes les manières |
| Raison | nepū uouerū pour une raison quelconque | ne uouerū sans raison | peri ? pourquoi? | peri pourquoi | samalī sindon donc | somū uouerū pour la même raison | allū uouerū pour une autre raison | ollū uouerū pour toutes les raisons |
Les cas utilisés avec chaque préposition sont flexibles et ne sont pas gravés dans le marbre. Une inscription semble contenir un rīs avec un nominatif. La grammaire prépositionnelle n'est pas vraiment précise.
| +acc. | +ins. | +dat. | +loc. | |
|---|---|---|---|---|
| ambi 💬 | autour, à peu près | autour, à peu près | ||
| ande 💬 | sous, au-dessous, | en haut de, provenant de | ||
| are 💬 | pour le bien de, à cause de, au nom de | devant, sur, à côté de | ||
| au 💬 | de, loin de | |||
| canti 💬 | près, avec | à côté de, parallèlement à | ||
| cēna 💬 | sans | |||
| dī 💬 | de | |||
| dō 💬 | à, vers, -vers | à, vers, -vers | ||
| dūcī 💬 | comme, autant que | comme, autant que | comme, autant que | |
| enter 💬 | entre, parmi, dans, à l'intérieur | parmi, entre, à l'intérieur, inter | ||
| eri 💬 | pendant, | pour, parce que, puisque, afin de | ||
| ēron 💬 | après, derrière | |||
| etic 💬 | accompagné de, avec | |||
| extrā 💬 | en dehors de | |||
| inte 💬 | au moyen de, avec | |||
| in 💬 | dans, à | dans, à l'intérieur de, à | dans, à l'intérieur de, à | |
| īssu 💬 | en dessous, jusqu'à | |||
| onco 💬 | à côté de | |||
| po 💬 | jusqu'à | |||
| rīs 💬 | devant, partie antérieure | devant, partie antérieure | ||
| samalī 💬 | comme, 'à la ressemblance de' | comme, 'à la ressemblance de' | ||
| sepans 💬 | après, 'suivant', le long de, selon | |||
| sepū 💬 | outre, à part, passé, au-delà, sans | |||
| trāns 💬 | à travers | |||
| tras 💬 | au-delà, à travers, par-dessus | de l'autre côté de | ||
| trē 💬 | à travers | |||
| uēdo 💬 | en présence de | |||
| uer 💬 | en haut, vers le haut, par-dessus | sur, au-dessus | ||
| uo 💬 | vers le bas | sous, au-dessous | ||
| ūxs 💬 | au-dessus |
| Personne | Sujet | Objet |
|---|---|---|
| 1er sg. | -mī 💬 | -mī 💬 |
| 1er pl. | -nīs 💬 | -nīs 💬 |
| 2e sg. | -tū 💬, -ti 💬 | -te 💬, -ti 💬 |
| 2e pl. | -suīs 💬 | -suīs 💬 |
| 3ème sg. fem. | -sī 💬, -iā 💬 | -ian 💬 |
| 3ème sg. masc. | -i 💬, -is 💬 | -in 💬 |
| 3ème sg. neu. | -i 💬, -id 💬 | -i 💬, -id 💬 |
| 3ème pl. fem. | -sies 💬 | -iās 💬 |
| 3ème pl. masc. | -íis 💬 | -iūs 💬 |
| 3ème pl. neu. | -ī 💬, -iā 💬 | -ī 💬, -iā 💬 |
| (relatif) | -io 💬 | -ion 💬 |
Les enclitiques pronominaux ont pour fonction d'accentuer le sujet et/ou le complément d'objet du verbe. Si le verbe est déplacé au début de la phrase pour l'accentuer, un enclitique pronominal est obligatoire. Souvent, on utilise alors un enclitique dénué de sens, -i ou -id. Ce terme n'a pas la même signification que le neutre -i(d), mais se rapproche davantage du grec ancien δε (« et »). Le verbe peut également être précédé de it(a), signifiant approximativement « ainsi ». it(a) et -i(d) sont tous deux facultatifs, sauf si le verbe est placé au début de la phrase. Comparez :
D'après les attestations, la forme -i du 3e masc. singulier, présente comme sioxti et peut-être *dōsioxti (écrit « tośokote »), est probablement employée pour éviter toute confusion avec l'impératif du 2e pluriel. Par exemple, le verbe attesté « ibetis » (*ibetes), « buvez ! », serait facilement confondu avec ibet-is « il boit », à moins que ce dernier ne soit devenue ibet-i, ce qui concorde avec les attestations concernant sioxt-i. Certaines sources donnent le mot sioxti entier comme prétérit de sagiet (chercher), ou même comme adverbe signifiant « de plus ». Cependant, sioxt a du sens en tant que prétérit en t dérivé d'un *sesagt/*sesaxt antérieur, remodelé d'après d'autres prétérits en t comme PC. *maketi, *maxt, du PC. *sagyeti, *sesāge original.
| Actif | Moyenne | Passif | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicatif | Subjonctif | Optatif | Indicatif | Subjonctif | ||
| Présent | 1st | bināiū 💬 | bināsū 💬 | bināsiōr 💬 | bināiōr 💬 | bināsōr 💬 |
| 2nd | binās 💬 | bināses 💬 | bināsitār 💬 | binātār 💬 | bināsetār 💬 | |
| 3rd | bināt 💬 | bināset 💬 | bināsitor 💬 | binātor 💬 | bināsetor 💬 | |
| 1pl | bināmas 💬 | bināsomos 💬 | bināsimor 💬 | bināmar 💬 | bināsomor 💬 | |
| 2pl | bināte 💬 | bināsete 💬 | bināsidue 💬 | binādue 💬 | bināsedue 💬 | |
| 3pl | binānt 💬 | bināsont 💬 | bināsintor 💬 | bināntor 💬 | bināsontor 💬 | |
| Futur | 1st | bināsiū 💬 | - | - | bināsiōr 💬 | - |
| 2nd | bināsies 💬 | - | - | bināsietār 💬 | - | |
| 3rd | bināsiet 💬 | - | - | bināsietor 💬 | - | |
| 1pl | bināsiomos 💬 | - | - | bināsiomor 💬 | - | |
| 2pl | bināsiete 💬 | - | - | bināsiedue 💬 | - | |
| 3pl | bināsiont 💬 | - | - | bināsiontor 💬 | - | |
| Imparfait | 1st | bināman 💬 | - | - | bināmar 💬 | - |
| 2nd | binātās 💬 | - | - | binātār 💬 | - | |
| 3rd | bināto 💬 | - | - | binātor 💬 | - | |
| 1pl | bināmo 💬 | - | - | bināmor 💬 | - | |
| 2pl | binātē 💬 | - | - | bināduē 💬 | - | |
| 3pl | binānto 💬 | - | - | bināntor 💬 | - | |
| Prétérit | 1st | biba 💬 | bibasīn 💬 | - | bītos/ā/on immi | bītos/ā/on siū |
| 2nd | bibas 💬 | bibasīs 💬 | - | bītos/ā/on ei | bītos/ā/on sies | |
| 3rd | bibe 💬 | bibasīt 💬 | - | bītos/ā/on eꟈꟈi | bītos/ā/on siet | |
| 1pl | bibamo 💬 | bibasīmos 💬 | - | bītos/ā/on emos | bītos/ā/on siomos | |
| 2pl | bibate 💬 | bibasīte 💬 | - | bītos/ā/on esue | bītos/ā/on siete | |
| 3pl | bibar 💬 | bibasīnt 💬 | - | bītos/ā/on sent | bītos/ā/on siont | |
| Imparfaitif | Aoriste | |||||
| Impératif | 1st | - | - | |||
| 2nd | binā 💬 | bīxs 💬 | ||||
| 3rd | binātū 💬 | bīxstū 💬 | ||||
| 1pl | bināmas 💬 | bīxsomo 💬 | ||||
| 2pl | binātes 💬 | bīxsetes 💬 | ||||
| 3pl | bināntū 💬 | bīxsontū 💬 | ||||
| Actif | Moyenne | Passif | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicatif | Subjonctif | Optatif | Indicatif | Subjonctif | ||
| Présent | 1st | cambiíū 💬 | cambīsū 💬 | cambīsiōr 💬 | cambiōr 💬 | cambīsōr 💬 |
| 2nd | cambīs 💬 | cambīses 💬 | cambīsitār 💬 | cambītār 💬 | cambīsetār 💬 | |
| 3rd | cambīt 💬 | cambīset 💬 | cambīsitor 💬 | cambītor 💬 | cambīsetor 💬 | |
| 1pl | cambīmas 💬 | cambīsomos 💬 | cambīsimor 💬 | cambīmar 💬 | cambīsomor 💬 | |
| 2pl | cambīte 💬 | cambīsete 💬 | cambīsidue 💬 | cambīdue 💬 | cambīsedue 💬 | |
| 3pl | cambīnt 💬 | cambīsont 💬 | cambīsintor 💬 | cambīntor 💬 | cambīsontor 💬 | |
| Futur | 1st | cambīsiū 💬 | - | - | cambīsiōr 💬 | - |
| 2nd | cambīsies 💬 | - | - | cambīsietār 💬 | - | |
| 3rd | cambīsiet 💬 | - | - | cambīsietor 💬 | - | |
| 1pl | cambīsiomos 💬 | - | - | cambīsiomor 💬 | - | |
| 2pl | cambīsiete 💬 | - | - | cambīsiedue 💬 | - | |
| 3pl | cambīsiont 💬 | - | - | cambīsiontor 💬 | - | |
| Imparfait | 1st | cambīman 💬 | - | - | cambīmar 💬 | - |
| 2nd | cambītās 💬 | - | - | cambītār 💬 | - | |
| 3rd | cambīto 💬 | - | - | cambītor 💬 | - | |
| 1pl | cambīmo 💬 | - | - | cambīmor 💬 | - | |
| 2pl | cambītē 💬 | - | - | cambīduē 💬 | - | |
| 3pl | cambīnto 💬 | - | - | cambīntor 💬 | - | |
| Prétérit | 1st | ro-cambīsan 💬 | ro-cambīsīn 💬 | - | cambītos/ā/on immi | cambītos/ā/on siū |
| 2nd | ro-cambīss 💬 | ro-cambīsīs 💬 | - | cambītos/ā/on ei | cambītos/ā/on sies | |
| 3rd | ro-cambīꟈ 💬 | ro-cambīsīt 💬 | - | cambītos/ā/on eꟈꟈi | cambītos/ā/on siet | |
| 1pl | ro-cambīsame 💬 | ro-cambīsīmos 💬 | - | cambītos/ā/on emos | cambītos/ā/on siomos | |
| 2pl | ro-cambīste 💬 | ro-cambīsīte 💬 | - | cambītos/ā/on esue | cambītos/ā/on siete | |
| 3pl | ro-cambīsant 💬 | ro-cambīsīnt 💬 | - | cambītos/ā/on sent | cambītos/ā/on siont | |
| Imparfaitif | Aoriste | |||||
| Impératif | 1st | - | - | |||
| 2nd | cambī 💬 | ro-cambīs 💬 | ||||
| 3rd | cambītū 💬 | ro-cambīstū 💬 | ||||
| 1pl | cambīmas 💬 | ro-cambīsomo 💬 | ||||
| 2pl | cambītes 💬 | ro-cambīsetes 💬 | ||||
| 3pl | cambīntū 💬 | ro-cambīsontū 💬 | ||||
Il s'agit de la plus grande classe de verbes gaulois, les verbes à radical consonantique à terminaison simple, et on y trouve une grande variété de radicaux ainsi que de prétérits. Cette page propose une large sélection de verbes, non pas pour imposer au lecteur une tâche de mémorisation fastidieuse, mais pour illustrer cette variabilité, et la façon dont les consonnes se combinent avec les terminaisons du futur et du subjonctif, comme c+s = xs, p+s = xs, t+s = ꟈꟈ, etc.
Comme pour toutes les autres conjugaisons, alors que la terminaison passive à la première personne du singulier est généralement reconstruite en -ūr, d'après les changements phonétiques connus en proto-celtique, en gaulois, cette terminaison est systématiquement attestée en -or, ce qui indique que la voyelle était passée de U à O à l'époque des inscriptions connues. Par conséquent, je reconstruis -ōr comme la terminaison passive de la première singulière, en notant que les sons ō et ū étaient probablement très proches.
| Actif | Moyenne | Passif | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicatif | Subjonctif | Optatif | Indicatif | Subjonctif | ||
| Présent | 1st | berū 💬 | berasū 💬 | berasiōr 💬 | berōr 💬 | berasōr 💬 |
| 2nd | beres 💬 | berases 💬 | berasitār 💬 | beretār 💬 | berasetār 💬 | |
| 3rd | beret 💬 | beraset 💬 | berasitor 💬 | beretor 💬 | berasetor 💬 | |
| 1pl | beromos 💬 | berasomos 💬 | berasimor 💬 | beromor 💬 | berasomor 💬 | |
| 2pl | berete 💬 | berasete 💬 | berasidue 💬 | beredue 💬 | berasedue 💬 | |
| 3pl | beront 💬 | berasont 💬 | berasintor 💬 | berontor 💬 | berasontor 💬 | |
| Futur | 1st | berasiū 💬 | - | - | berasiōr 💬 | - |
| 2nd | berasies 💬 | - | - | berasietār 💬 | - | |
| 3rd | berasiet 💬 | - | - | berasietor 💬 | - | |
| 1pl | berasiomos 💬 | - | - | berasiomor 💬 | - | |
| 2pl | berasiete 💬 | - | - | berasiedue 💬 | - | |
| 3pl | berasiont 💬 | - | - | berasiontor 💬 | - | |
| Imparfait | 1st | bereman 💬 | - | - | beremar 💬 | - |
| 2nd | beretās 💬 | - | - | beretār 💬 | - | |
| 3rd | bereto 💬 | - | - | beretor 💬 | - | |
| 1pl | beremo 💬 | - | - | beremor 💬 | - | |
| 2pl | beretē 💬 | - | - | bereduē 💬 | - | |
| 3pl | berento 💬 | - | - | berentor 💬 | - | |
| Prétérit | 1st | beran 💬 | berasīn 💬 | - | britos/ā/on immi | britos/ā/on siū |
| 2nd | bers 💬 | berasīs 💬 | - | britos/ā/on ei | britos/ā/on sies | |
| 3rd | bert 💬 | berasīt 💬 | - | britos/ā/on eꟈꟈi | britos/ā/on siet | |
| 1pl | berame 💬 | berasīmos 💬 | - | britos/ā/on emos | britos/ā/on siomos | |
| 2pl | berte 💬 | berasīte 💬 | - | britos/ā/on esue | britos/ā/on siete | |
| 3pl | berant 💬 | berasīnt 💬 | - | britos/ā/on sent | britos/ā/on siont | |
| Imparfaitif | Aoriste | |||||
| Impératif | 1st | - | - | |||
| 2nd | bere 💬 | bērs 💬 | ||||
| 3rd | beretū 💬 | bērstū 💬 | ||||
| 1pl | beromo 💬 | bērsomo 💬 | ||||
| 2pl | beretes 💬 | bērsetes 💬 | ||||
| 3pl | berontū 💬 | bērsontū 💬 | ||||
| Actif | Moyenne | |||
|---|---|---|---|---|
| Indicatif | Subjonctif | Optatif | ||
| Présent | 1st | brennū 💬 | brennasū 💬 | brennasiōr 💬 |
| 2nd | brennes 💬 | brennases 💬 | brennasitār 💬 | |
| 3rd | brennet 💬 | brennaset 💬 | brennasitor 💬 | |
| 1pl | brennomos 💬 | brennasomos 💬 | brennasimor 💬 | |
| 2pl | brennete 💬 | brennasete 💬 | brennasidue 💬 | |
| 3pl | brennont 💬 | brennasont 💬 | brennasintor 💬 | |
| Futur | 1st | brennasiū 💬 | - | - |
| 2nd | brennasies 💬 | - | - | |
| 3rd | brennasiet 💬 | - | - | |
| 1pl | brennasiomos 💬 | - | - | |
| 2pl | brennasiete 💬 | - | - | |
| 3pl | brennasiont 💬 | - | - | |
| Imparfait | 1st | brenneman 💬 | - | - |
| 2nd | brennetās 💬 | - | - | |
| 3rd | brenneto 💬 | - | - | |
| 1pl | brennemo 💬 | - | - | |
| 2pl | brennetē 💬 | - | - | |
| 3pl | brennento 💬 | - | - | |
| Prétérit | 1st | bebronna 💬 | bebronnasīn 💬 | - |
| 2nd | bebronnas 💬 | bebronnasīs 💬 | - | |
| 3rd | bebronne 💬 | bebronnasīt 💬 | - | |
| 1pl | bebronnamo 💬 | bebronnasīmos 💬 | - | |
| 2pl | bebronnate 💬 | bebronnasīte 💬 | - | |
| 3pl | bebronnar 💬 | bebronnasīnt 💬 | - | |
| Imparfaitif | Aoriste | |||
| Impératif | 1st | - | - | |
| 2nd | brenne 💬 | bebronnas 💬 | ||
| 3rd | brennetū 💬 | bebronnastū 💬 | ||
| 1pl | brennomo 💬 | bebronnasomo 💬 | ||
| 2pl | brennetes 💬 | bebronnasetes 💬 | ||
| 3pl | brennontū 💬 | bebronnasontū 💬 | ||
| Actif | Moyenne | Passif | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicatif | Subjonctif | Optatif | Indicatif | Subjonctif | ||
| Présent | 1st | deprū 💬 | deprasū 💬 | deprasiōr 💬 | deprōr 💬 | deprasōr 💬 |
| 2nd | depres 💬 | deprases 💬 | deprasitār 💬 | depretār 💬 | deprasetār 💬 | |
| 3rd | depret 💬 | depraset 💬 | deprasitor 💬 | depretor 💬 | deprasetor 💬 | |
| 1pl | depromos 💬 | deprasomos 💬 | deprasimor 💬 | depromor 💬 | deprasomor 💬 | |
| 2pl | deprete 💬 | deprasete 💬 | deprasidue 💬 | depredue 💬 | deprasedue 💬 | |
| 3pl | depront 💬 | deprasont 💬 | deprasintor 💬 | deprontor 💬 | deprasontor 💬 | |
| Futur | 1st | deprasiū 💬 | - | - | deprasiōr 💬 | - |
| 2nd | deprasies 💬 | - | - | deprasietār 💬 | - | |
| 3rd | deprasiet 💬 | - | - | deprasietor 💬 | - | |
| 1pl | deprasiomos 💬 | - | - | deprasiomor 💬 | - | |
| 2pl | deprasiete 💬 | - | - | deprasiedue 💬 | - | |
| 3pl | deprasiont 💬 | - | - | deprasiontor 💬 | - | |
| Imparfait | 1st | depreman 💬 | - | - | depremar 💬 | - |
| 2nd | depretās 💬 | - | - | depretār 💬 | - | |
| 3rd | depreto 💬 | - | - | depretor 💬 | - | |
| 1pl | depremo 💬 | - | - | depremor 💬 | - | |
| 2pl | depretē 💬 | - | - | depreduē 💬 | - | |
| 3pl | deprento 💬 | - | - | deprentor 💬 | - | |
| Prétérit | 1st | dedopra 💬 | dedoprasīn 💬 | - | depretos/ā/on immi | depretos/ā/on siū |
| 2nd | dedopras 💬 | dedoprasīs 💬 | - | depretos/ā/on ei | depretos/ā/on sies | |
| 3rd | dedopre 💬 | dedoprasīt 💬 | - | depretos/ā/on eꟈꟈi | depretos/ā/on siet | |
| 1pl | dedopramo 💬 | dedoprasīmos 💬 | - | depretos/ā/on emos | depretos/ā/on siomos | |
| 2pl | dedoprate 💬 | dedoprasīte 💬 | - | depretos/ā/on esue | depretos/ā/on siete | |
| 3pl | dedoprar 💬 | dedoprasīnt 💬 | - | depretos/ā/on sent | depretos/ā/on siont | |
| Imparfaitif | Aoriste | |||||
| Impératif | 1st | - | - | |||
| 2nd | depre 💬 | dedopras 💬 | ||||
| 3rd | depretū 💬 | dedoprastū 💬 | ||||
| 1pl | depromo 💬 | dedoprasomo 💬 | ||||
| 2pl | depretes 💬 | dedoprasetes 💬 | ||||
| 3pl | deprontū 💬 | dedoprasontū 💬 | ||||
| Actif | Moyenne | Passif | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicatif | Subjonctif | Optatif | Indicatif | Subjonctif | ||
| Présent | 1st | ibū 💬 | ixsū 💬 | ixsiōr 💬 | ibōr 💬 | ixsōr 💬 |
| 2nd | ibes 💬 | ixses 💬 | ixsitār 💬 | ibetār 💬 | ixsetār 💬 | |
| 3rd | ibet 💬 | ixset 💬 | ixsitor 💬 | ibetor 💬 | ixsetor 💬 | |
| 1pl | ibomos 💬 | ixsomos 💬 | ixsimor 💬 | ibomor 💬 | ixsomor 💬 | |
| 2pl | ibete 💬 | ixsete 💬 | ixsidue 💬 | ibedue 💬 | ixsedue 💬 | |
| 3pl | ibont 💬 | ixsont 💬 | ixsintor 💬 | ibontor 💬 | ixsontor 💬 | |
| Futur | 1st | ixsiū 💬 | - | - | ixsiōr 💬 | - |
| 2nd | ixsies 💬 | - | - | ixsietār 💬 | - | |
| 3rd | ixsiet 💬 | - | - | ixsietor 💬 | - | |
| 1pl | ixsiomos 💬 | - | - | ixsiomor 💬 | - | |
| 2pl | ixsiete 💬 | - | - | ixsiedue 💬 | - | |
| 3pl | ixsiont 💬 | - | - | ixsiontor 💬 | - | |
| Imparfait | 1st | ibeman 💬 | - | - | ibemar 💬 | - |
| 2nd | ibetās 💬 | - | - | ibetār 💬 | - | |
| 3rd | ibeto 💬 | - | - | ibetor 💬 | - | |
| 1pl | ibemo 💬 | - | - | ibemor 💬 | - | |
| 2pl | ibetē 💬 | - | - | ibeduē 💬 | - | |
| 3pl | ibento 💬 | - | - | ibentor 💬 | - | |
| Prétérit | 1st | ixsan 💬 | ixsīn 💬 | - | ixtos/ā/on immi | ixtos/ā/on siū |
| 2nd | ixses 💬 | ixsīs 💬 | - | ixtos/ā/on ei | ixtos/ā/on sies | |
| 3rd | ixset 💬 | ixsīt 💬 | - | ixtos/ā/on eꟈꟈi | ixtos/ā/on siet | |
| 1pl | ixsame 💬 | ixsīmos 💬 | - | ixtos/ā/on emos | ixtos/ā/on siomos | |
| 2pl | ixsate 💬 | ixsīte 💬 | - | ixtos/ā/on esue | ixtos/ā/on siete | |
| 3pl | ixsant 💬 | ixsīnt 💬 | - | ixtos/ā/on sent | ixtos/ā/on siont | |
| Imparfaitif | Aoriste | |||||
| Impératif | 1st | - | - | |||
| 2nd | ibe 💬 | īxs 💬 | ||||
| 3rd | ibetū 💬 | īxstū 💬 | ||||
| 1pl | ibomo 💬 | īxsomo 💬 | ||||
| 2pl | ibetes 💬 | īxsetes 💬 | ||||
| 3pl | ibontū 💬 | īxsontū 💬 | ||||
| Actif | Moyenne | Passif | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicatif | Subjonctif | Optatif | Indicatif | Subjonctif | ||
| Présent | 1st | orgū 💬 | orxsū 💬 | orxsiōr 💬 | orgōr 💬 | orxsōr 💬 |
| 2nd | orges 💬 | orxses 💬 | orxsitār 💬 | orgetār 💬 | orxsetār 💬 | |
| 3rd | orget 💬 | orxset 💬 | orxsitor 💬 | orgetor 💬 | orxsetor 💬 | |
| 1pl | orgomos 💬 | orxsomos 💬 | orxsimor 💬 | orgomor 💬 | orxsomor 💬 | |
| 2pl | orgete 💬 | orxsete 💬 | orxsidue 💬 | orgedue 💬 | orxsedue 💬 | |
| 3pl | orgont 💬 | orxsont 💬 | orxsintor 💬 | orgontor 💬 | orxsontor 💬 | |
| Futur | 1st | orxsiū 💬 | - | - | orxsiōr 💬 | - |
| 2nd | orxsies 💬 | - | - | orxsietār 💬 | - | |
| 3rd | orxsiet 💬 | - | - | orxsietor 💬 | - | |
| 1pl | orxsiomos 💬 | - | - | orxsiomor 💬 | - | |
| 2pl | orxsiete 💬 | - | - | orxsiedue 💬 | - | |
| 3pl | orxsiont 💬 | - | - | orxsiontor 💬 | - | |
| Imparfait | 1st | orgeman 💬 | - | - | orgemar 💬 | - |
| 2nd | orgetās 💬 | - | - | orgetār 💬 | - | |
| 3rd | orgeto 💬 | - | - | orgetor 💬 | - | |
| 1pl | orgemo 💬 | - | - | orgemor 💬 | - | |
| 2pl | orgetē 💬 | - | - | orgeduē 💬 | - | |
| 3pl | orgento 💬 | - | - | orgentor 💬 | - | |
| Prétérit | 1st | organ 💬 | orxsīn 💬 | - | orxtos/ā/on immi | orxtos/ā/on siū |
| 2nd | orxs 💬 | orxsīs 💬 | - | orxtos/ā/on ei | orxtos/ā/on sies | |
| 3rd | orxt 💬 | orxsīt 💬 | - | orxtos/ā/on eꟈꟈi | orxtos/ā/on siet | |
| 1pl | orgame 💬 | orxsīmos 💬 | - | orxtos/ā/on emos | orxtos/ā/on siomos | |
| 2pl | orxte 💬 | orxsīte 💬 | - | orxtos/ā/on esue | orxtos/ā/on siete | |
| 3pl | organt 💬 | orxsīnt 💬 | - | orxtos/ā/on sent | orxtos/ā/on siont | |
| Imparfaitif | Aoriste | |||||
| Impératif | 1st | - | - | |||
| 2nd | orge 💬 | ōrxs 💬 | ||||
| 3rd | orgetū 💬 | ōrxstū 💬 | ||||
| 1pl | orgomo 💬 | ōrxsomo 💬 | ||||
| 2pl | orgetes 💬 | ōrxsetes 💬 | ||||
| 3pl | orgontū 💬 | ōrxsontū 💬 | ||||
| Actif | Moyenne | Passif | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicatif | Subjonctif | Optatif | Indicatif | Subjonctif | ||
| Présent | 1st | ratū 💬 | raꟈꟈū 💬 | raꟈꟈiōr 💬 | ratōr 💬 | raꟈꟈōr 💬 |
| 2nd | rates 💬 | raꟈꟈes 💬 | raꟈꟈitār 💬 | ratetār 💬 | raꟈꟈetār 💬 | |
| 3rd | ratet 💬 | raꟈꟈet 💬 | raꟈꟈitor 💬 | ratetor 💬 | raꟈꟈetor 💬 | |
| 1pl | ratomos 💬 | raꟈꟈomos 💬 | raꟈꟈimor 💬 | ratomor 💬 | raꟈꟈomor 💬 | |
| 2pl | ratete 💬 | raꟈꟈete 💬 | raꟈꟈidue 💬 | ratedue 💬 | raꟈꟈedue 💬 | |
| 3pl | ratont 💬 | raꟈꟈont 💬 | raꟈꟈintor 💬 | ratontor 💬 | raꟈꟈontor 💬 | |
| Futur | 1st | raꟈꟈiū 💬 | - | - | raꟈꟈiōr 💬 | - |
| 2nd | raꟈꟈies 💬 | - | - | raꟈꟈietār 💬 | - | |
| 3rd | raꟈꟈiet 💬 | - | - | raꟈꟈietor 💬 | - | |
| 1pl | raꟈꟈiomos 💬 | - | - | raꟈꟈiomor 💬 | - | |
| 2pl | raꟈꟈiete 💬 | - | - | raꟈꟈiedue 💬 | - | |
| 3pl | raꟈꟈiont 💬 | - | - | raꟈꟈiontor 💬 | - | |
| Imparfait | 1st | rateman 💬 | - | - | ratemar 💬 | - |
| 2nd | ratetās 💬 | - | - | ratetār 💬 | - | |
| 3rd | rateto 💬 | - | - | ratetor 💬 | - | |
| 1pl | ratemo 💬 | - | - | ratemor 💬 | - | |
| 2pl | ratetē 💬 | - | - | rateduē 💬 | - | |
| 3pl | ratento 💬 | - | - | ratentor 💬 | - | |
| Prétérit | 1st | rerata 💬 | reratasīn 💬 | - | rassos/ā/on immi | rassos/ā/on siū |
| 2nd | reratas 💬 | reratasīs 💬 | - | rassos/ā/on ei | rassos/ā/on sies | |
| 3rd | rerate 💬 | reratasīt 💬 | - | rassos/ā/on eꟈꟈi | rassos/ā/on siet | |
| 1pl | reratamo 💬 | reratasīmos 💬 | - | rassos/ā/on emos | rassos/ā/on siomos | |
| 2pl | reratate 💬 | reratasīte 💬 | - | rassos/ā/on esue | rassos/ā/on siete | |
| 3pl | reratar 💬 | reratasīnt 💬 | - | rassos/ā/on sent | rassos/ā/on siont | |
| Imparfaitif | Aoriste | |||||
| Impératif | 1st | - | - | |||
| 2nd | rate 💬 | rerāꟈ 💬 | ||||
| 3rd | ratetū 💬 | rerāꟈtū 💬 | ||||
| 1pl | ratomo 💬 | rerāꟈomo 💬 | ||||
| 2pl | ratetes 💬 | rerāꟈetes 💬 | ||||
| 3pl | ratontū 💬 | rerāꟈontū 💬 | ||||
| Actif | Moyenne | Passif | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicatif | Subjonctif | Optatif | Indicatif | Subjonctif | ||
| Présent | 1st | appisū 💬 | appissiíū 💬 | appissiísiōr 💬 | appisōr 💬 | appissiíōr 💬 |
| 2nd | appises 💬 | appissiíes 💬 | appissiísitār 💬 | appisetār 💬 | appissiíetār 💬 | |
| 3rd | appiset 💬 | appissiíet 💬 | appissiísitor 💬 | appisetor 💬 | appissiíetor 💬 | |
| 1pl | appisomos 💬 | appissiíomos 💬 | appissiísimor 💬 | appisomor 💬 | appissiíomor 💬 | |
| 2pl | appisete 💬 | appissiíete 💬 | appissiísidue 💬 | appisedue 💬 | appissiíedue 💬 | |
| 3pl | appisont 💬 | appissiíont 💬 | appissiísintor 💬 | appisontor 💬 | appissiíontor 💬 | |
| Futur | 1st | appiíū 💬 | - | - | appiíōr 💬 | - |
| 2nd | appiíes 💬 | - | - | appiíetār 💬 | - | |
| 3rd | appiíet 💬 | - | - | appiíetor 💬 | - | |
| 1pl | appiíomos 💬 | - | - | appiíomor 💬 | - | |
| 2pl | appiíete 💬 | - | - | appiíedue 💬 | - | |
| 3pl | appiíont 💬 | - | - | appiíontor 💬 | - | |
| Imparfait | 1st | appiseman 💬 | - | - | appisemar 💬 | - |
| 2nd | appisetās 💬 | - | - | appisetār 💬 | - | |
| 3rd | appiseto 💬 | - | - | appisetor 💬 | - | |
| 1pl | appisemo 💬 | - | - | appisemor 💬 | - | |
| 2pl | appisetē 💬 | - | - | appiseduē 💬 | - | |
| 3pl | appisento 💬 | - | - | appisentor 💬 | - | |
| Prétérit | 1st | ad-pepisa 💬 | ad-pepisasīn 💬 | - | appiꟈꟈos/ā/on immi | appiꟈꟈos/ā/on siū |
| 2nd | ad-pepisas 💬 | ad-pepisasīs 💬 | - | appiꟈꟈos/ā/on ei | appiꟈꟈos/ā/on sies | |
| 3rd | ad-pepise 💬 | ad-pepisasīt 💬 | - | appiꟈꟈos/ā/on eꟈꟈi | appiꟈꟈos/ā/on siet | |
| 1pl | ad-pepisamo 💬 | ad-pepisasīmos 💬 | - | appiꟈꟈos/ā/on emos | appiꟈꟈos/ā/on siomos | |
| 2pl | ad-pepisate 💬 | ad-pepisasīte 💬 | - | appiꟈꟈos/ā/on esue | appiꟈꟈos/ā/on siete | |
| 3pl | ad-pepisar 💬 | ad-pepisasīnt 💬 | - | appiꟈꟈos/ā/on sent | appiꟈꟈos/ā/on siont | |
| Imparfaitif | Aoriste | |||||
| Impératif | 1st | - | - | |||
| 2nd | appise 💬 | ad-pepīss 💬 | ||||
| 3rd | appisetū 💬 | ad-pepīsstū 💬 | ||||
| 1pl | appisomo 💬 | ad-pepīssomo 💬 | ||||
| 2pl | appisetes 💬 | ad-pepīssetes 💬 | ||||
| 3pl | appisontū 💬 | ad-pepīssontū 💬 | ||||
Ce sont des verbes dont les radicaux se terminent par une consonne -i.
| Actif | Moyenne | Passif | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicatif | Subjonctif | Optatif | Indicatif | Subjonctif | ||
| Présent | 1st | uediíū 💬 | uediísū 💬 | uediísiōr 💬 | uediíōr 💬 | uediísōr 💬 |
| 2nd | uediíes 💬 | uediíses 💬 | uediísitār 💬 | uediíetār 💬 | uediísetār 💬 | |
| 3rd | uediíet 💬 | uediíset 💬 | uediísitor 💬 | uediíetor 💬 | uediísetor 💬 | |
| 1pl | uediíomos 💬 | uediísomos 💬 | uediísimor 💬 | uediíomor 💬 | uediísomor 💬 | |
| 2pl | uediíete 💬 | uediísete 💬 | uediísidue 💬 | uediíedue 💬 | uediísedue 💬 | |
| 3pl | uediíont 💬 | uediísont 💬 | uediísintor 💬 | uediíontor 💬 | uediísontor 💬 | |
| Futur | 1st | uediísiū 💬 | - | - | uediísiōr 💬 | - |
| 2nd | uediísies 💬 | - | - | uediísietār 💬 | - | |
| 3rd | uediísiet 💬 | - | - | uediísietor 💬 | - | |
| 1pl | uediísiomos 💬 | - | - | uediísiomor 💬 | - | |
| 2pl | uediísiete 💬 | - | - | uediísiedue 💬 | - | |
| 3pl | uediísiont 💬 | - | - | uediísiontor 💬 | - | |
| Imparfait | 1st | uediíeman 💬 | - | - | uediíemar 💬 | - |
| 2nd | uediíetās 💬 | - | - | uediíetār 💬 | - | |
| 3rd | uediíeto 💬 | - | - | uediíetor 💬 | - | |
| 1pl | uediíemo 💬 | - | - | uediíemor 💬 | - | |
| 2pl | uediíetē 💬 | - | - | uediíeduē 💬 | - | |
| 3pl | uediíento 💬 | - | - | uediíentor 💬 | - | |
| Prétérit | 1st | uōmi 💬 | usīn 💬 | - | uessos/ā/on immi | uessos/ā/on siū |
| 2nd | uōs 💬 | usīs 💬 | - | uessos/ā/on ei | uessos/ā/on sies | |
| 3rd | uōt 💬 | usīt 💬 | - | uessos/ā/on eꟈꟈi | uessos/ā/on siet | |
| 1pl | uōme 💬 | usīmos 💬 | - | uessos/ā/on emos | uessos/ā/on siomos | |
| 2pl | uōte 💬 | usīte 💬 | - | uessos/ā/on esue | uessos/ā/on siete | |
| 3pl | uōnt 💬 | usīnt 💬 | - | uessos/ā/on sent | uessos/ā/on siont | |
| Imparfaitif | Aoriste | |||||
| Impératif | 1st | - | - | |||
| 2nd | uediíe 💬 | ūs 💬 | ||||
| 3rd | uediíetū 💬 | ūstū 💬 | ||||
| 1pl | uediíomo 💬 | ūsomo 💬 | ||||
| 2pl | uediíetes 💬 | ūsetes 💬 | ||||
| 3pl | uediíontū 💬 | ūsontū 💬 | ||||
Notez le double-I dans le radical, ce qui donne les formes avec le radical uedi-.
| Actif | Moyenne | Passif | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicatif | Subjonctif | Optatif | Indicatif | Subjonctif | ||
| Présent | 1st | sagiū 💬 | saxsū 💬 | saxsiōr 💬 | sagiōr 💬 | saxsōr 💬 |
| 2nd | sagies 💬 | saxses 💬 | saxsitār 💬 | sagietār 💬 | saxsetār 💬 | |
| 3rd | sagiet 💬 | saxset 💬 | saxsitor 💬 | sagietor 💬 | saxsetor 💬 | |
| 1pl | sagiomos 💬 | saxsomos 💬 | saxsimor 💬 | sagiomor 💬 | saxsomor 💬 | |
| 2pl | sagiete 💬 | saxsete 💬 | saxsidue 💬 | sagiedue 💬 | saxsedue 💬 | |
| 3pl | sagiont 💬 | saxsont 💬 | saxsintor 💬 | sagiontor 💬 | saxsontor 💬 | |
| Futur | 1st | siaxsiū 💬 | - | - | siaxsiōr 💬 | - |
| 2nd | siaxsies 💬 | - | - | siaxsietār 💬 | - | |
| 3rd | siaxsiet 💬 | - | - | siaxsietor 💬 | - | |
| 1pl | siaxsiomos 💬 | - | - | siaxsiomor 💬 | - | |
| 2pl | siaxsiete 💬 | - | - | siaxsiedue 💬 | - | |
| 3pl | siaxsiont 💬 | - | - | siaxsiontor 💬 | - | |
| Imparfait | 1st | sagieman 💬 | - | - | sagiemar 💬 | - |
| 2nd | sagietās 💬 | - | - | sagietār 💬 | - | |
| 3rd | sagieto 💬 | - | - | sagietor 💬 | - | |
| 1pl | sagiemo 💬 | - | - | sagiemor 💬 | - | |
| 2pl | sagietē 💬 | - | - | sagieduē 💬 | - | |
| 3pl | sagiento 💬 | - | - | sagientor 💬 | - | |
| Prétérit | 1st | siogan 💬 | sioxsīn 💬 | - | saxtos/ā/on immi | saxtos/ā/on siū |
| 2nd | sioxs 💬 | sioxsīs 💬 | - | saxtos/ā/on ei | saxtos/ā/on sies | |
| 3rd | sioxt 💬 | sioxsīt 💬 | - | saxtos/ā/on eꟈꟈi | saxtos/ā/on siet | |
| 1pl | siogame 💬 | sioxsīmos 💬 | - | saxtos/ā/on emos | saxtos/ā/on siomos | |
| 2pl | sioxte 💬 | sioxsīte 💬 | - | saxtos/ā/on esue | saxtos/ā/on siete | |
| 3pl | siogant 💬 | sioxsīnt 💬 | - | saxtos/ā/on sent | saxtos/ā/on siont | |
| Imparfaitif | Aoriste | |||||
| Impératif | 1st | - | - | |||
| 2nd | sagie 💬 | siōxs 💬 | ||||
| 3rd | sagietū 💬 | siōxstū 💬 | ||||
| 1pl | sagiomo 💬 | siōxsomo 💬 | ||||
| 2pl | sagietes 💬 | siōxsetes 💬 | ||||
| 3pl | sagiontū 💬 | siōxsontū 💬 | ||||
Ces verbes se terminent par une nasale (m ou n) suivie d'une occlusive (b, g, t, etc.). Historiquement, ils étaient formés en infixant une nasale avant la fin du radical, par exemple, *la-m-b- de la racine *lab-, la nasale disparaissant aux temps autres que le présent et l'imparfait. Dans les langues celtiques, cet infixe nasal a été conservé à certains ou à tous les temps. Il est donc nécessaire de connaître le prétérit de chaque verbe pour savoir s'il conserve son infixe à toutes les formes.
| Actif | Moyenne | Passif | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicatif | Subjonctif | Optatif | Indicatif | Subjonctif | ||
| Présent | 1st | tangū 💬 | tanxsū 💬 | tanxsiōr 💬 | tangōr 💬 | tanxsōr 💬 |
| 2nd | tanges 💬 | tanxses 💬 | tanxsitār 💬 | tangetār 💬 | tanxsetār 💬 | |
| 3rd | tanget 💬 | tanxset 💬 | tanxsitor 💬 | tangetor 💬 | tanxsetor 💬 | |
| 1pl | tangomos 💬 | tanxsomos 💬 | tanxsimor 💬 | tangomor 💬 | tanxsomor 💬 | |
| 2pl | tangete 💬 | tanxsete 💬 | tanxsidue 💬 | tangedue 💬 | tanxsedue 💬 | |
| 3pl | tangont 💬 | tanxsont 💬 | tanxsintor 💬 | tangontor 💬 | tanxsontor 💬 | |
| Futur | 1st | tanxsiū 💬 | - | - | tanxsiōr 💬 | - |
| 2nd | tanxsies 💬 | - | - | tanxsietār 💬 | - | |
| 3rd | tanxsiet 💬 | - | - | tanxsietor 💬 | - | |
| 1pl | tanxsiomos 💬 | - | - | tanxsiomor 💬 | - | |
| 2pl | tanxsiete 💬 | - | - | tanxsiedue 💬 | - | |
| 3pl | tanxsiont 💬 | - | - | tanxsiontor 💬 | - | |
| Imparfait | 1st | tangeman 💬 | - | - | tangemar 💬 | - |
| 2nd | tangetās 💬 | - | - | tangetār 💬 | - | |
| 3rd | tangeto 💬 | - | - | tangetor 💬 | - | |
| 1pl | tangemo 💬 | - | - | tangemor 💬 | - | |
| 2pl | tangetē 💬 | - | - | tangeduē 💬 | - | |
| 3pl | tangento 💬 | - | - | tangentor 💬 | - | |
| Prétérit | 1st | taga 💬 | tagasīn 💬 | - | taxtos/ā/on immi | taxtos/ā/on siū |
| 2nd | tagas 💬 | tagasīs 💬 | - | taxtos/ā/on ei | taxtos/ā/on sies | |
| 3rd | tage 💬 | tagasīt 💬 | - | taxtos/ā/on eꟈꟈi | taxtos/ā/on siet | |
| 1pl | tagamo 💬 | tagasīmos 💬 | - | taxtos/ā/on emos | taxtos/ā/on siomos | |
| 2pl | tagate 💬 | tagasīte 💬 | - | taxtos/ā/on esue | taxtos/ā/on siete | |
| 3pl | tagar 💬 | tagasīnt 💬 | - | taxtos/ā/on sent | taxtos/ā/on siont | |
| Imparfaitif | Aoriste | |||||
| Impératif | 1st | - | - | |||
| 2nd | tange 💬 | tāxs 💬 | ||||
| 3rd | tangetū 💬 | tāxstū 💬 | ||||
| 1pl | tangomo 💬 | tāxsomo 💬 | ||||
| 2pl | tangetes 💬 | tāxsetes 💬 | ||||
| 3pl | tangontū 💬 | tāxsontū 💬 | ||||
| Actif | Moyenne | |||
|---|---|---|---|---|
| Indicatif | Subjonctif | Optatif | ||
| Présent | 1st | gandū 💬 | ganꟈꟈū 💬 | ganꟈꟈiōr 💬 |
| 2nd | gandes 💬 | ganꟈꟈes 💬 | ganꟈꟈitār 💬 | |
| 3rd | gandet 💬 | ganꟈꟈet 💬 | ganꟈꟈitor 💬 | |
| 1pl | gandomos 💬 | ganꟈꟈomos 💬 | ganꟈꟈimor 💬 | |
| 2pl | gandete 💬 | ganꟈꟈete 💬 | ganꟈꟈidue 💬 | |
| 3pl | gandont 💬 | ganꟈꟈont 💬 | ganꟈꟈintor 💬 | |
| Futur | 1st | ganꟈꟈiū 💬 | - | - |
| 2nd | ganꟈꟈies 💬 | - | - | |
| 3rd | ganꟈꟈiet 💬 | - | - | |
| 1pl | ganꟈꟈiomos 💬 | - | - | |
| 2pl | ganꟈꟈiete 💬 | - | - | |
| 3pl | ganꟈꟈiont 💬 | - | - | |
| Imparfait | 1st | gandeman 💬 | - | - |
| 2nd | gandetās 💬 | - | - | |
| 3rd | gandeto 💬 | - | - | |
| 1pl | gandemo 💬 | - | - | |
| 2pl | gandetē 💬 | - | - | |
| 3pl | gandento 💬 | - | - | |
| Prétérit | 1st | geganda 💬 | gegandasīn 💬 | - |
| 2nd | gegandas 💬 | gegandasīs 💬 | - | |
| 3rd | gegande 💬 | gegandasīt 💬 | - | |
| 1pl | gegandamo 💬 | gegandasīmos 💬 | - | |
| 2pl | gegandate 💬 | gegandasīte 💬 | - | |
| 3pl | gegandar 💬 | gegandasīnt 💬 | - | |
| Imparfaitif | Aoriste | |||
| Impératif | 1st | - | - | |
| 2nd | gande 💬 | gegānꟈ 💬 | ||
| 3rd | gandetū 💬 | gegānꟈtū 💬 | ||
| 1pl | gandomo 💬 | gegānꟈomo 💬 | ||
| 2pl | gandetes 💬 | gegānꟈetes 💬 | ||
| 3pl | gandontū 💬 | gegānꟈontū 💬 | ||
| Actif | Moyenne | Passif | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicatif | Subjonctif | Optatif | Indicatif | Subjonctif | ||
| Présent | 1st | prinami 💬 | priān 💬 | prisiōr 💬 | prinār 💬 | priār 💬 |
| 2nd | prinasi 💬 | priaisi 💬 | prisitār 💬 | prinatār 💬 | priaitār 💬 | |
| 3rd | prinat 💬 | priait 💬 | prisitor 💬 | prinator 💬 | priaitor 💬 | |
| 1pl | prinamos 💬 | priaomos 💬 | prisimor 💬 | prinamor 💬 | priaomor 💬 | |
| 2pl | prinate 💬 | priaite 💬 | prisidue 💬 | prinadue 💬 | priaidue 💬 | |
| 3pl | prinant 💬 | priaont 💬 | prisintor 💬 | prinantor 💬 | priaontor 💬 | |
| Futur | 1st | prinasiū 💬 | - | - | prinasiōr 💬 | - |
| 2nd | prinasies 💬 | - | - | prinasietār 💬 | - | |
| 3rd | prinasiet 💬 | - | - | prinasietor 💬 | - | |
| 1pl | prinasiomos 💬 | - | - | prinasiomor 💬 | - | |
| 2pl | prinasiete 💬 | - | - | prinasiedue 💬 | - | |
| 3pl | prinasiont 💬 | - | - | prinasiontor 💬 | - | |
| Imparfait | 1st | prinaman 💬 | - | - | prinamar 💬 | - |
| 2nd | prinatās 💬 | - | - | prinatār 💬 | - | |
| 3rd | prinato 💬 | - | - | prinator 💬 | - | |
| 1pl | prinamo 💬 | - | - | prinamor 💬 | - | |
| 2pl | prinatē 💬 | - | - | prinaduē 💬 | - | |
| 3pl | prinanto 💬 | - | - | prinantor 💬 | - | |
| Prétérit | 1st | pipra 💬 | piprāsīn 💬 | - | prītos/ā/on immi | prītos/ā/on siū |
| 2nd | pipras 💬 | piprāsīs 💬 | - | prītos/ā/on ei | prītos/ā/on sies | |
| 3rd | pipre 💬 | piprāsīt 💬 | - | prītos/ā/on eꟈꟈi | prītos/ā/on siet | |
| 1pl | pipramo 💬 | piprāsīmos 💬 | - | prītos/ā/on emos | prītos/ā/on siomos | |
| 2pl | piprate 💬 | piprāsīte 💬 | - | prītos/ā/on esue | prītos/ā/on siete | |
| 3pl | piprar 💬 | piprāsīnt 💬 | - | prītos/ā/on sent | prītos/ā/on siont | |
| Imparfaitif | Aoriste | |||||
| Impératif | 1st | - | - | |||
| 2nd | prina 💬 | piprās 💬 | ||||
| 3rd | prinatū 💬 | piprāstū 💬 | ||||
| 1pl | prinamas 💬 | piprāsomo 💬 | ||||
| 2pl | prinates 💬 | piprāsetes 💬 | ||||
| 3pl | prinantū 💬 | piprāsontū 💬 | ||||
| Déposant | Moyenne | |||
|---|---|---|---|---|
| Indicatif | Subjonctif | Optatif | ||
| Présent | 1st | clinōr 💬 | clinusōr 💬 | clinusiōr 💬 |
| 2nd | clinutār 💬 | clinusetār 💬 | clinusitār 💬 | |
| 3rd | clinutor 💬 | clinusetor 💬 | clinusitor 💬 | |
| 1pl | clinumor 💬 | clinusomor 💬 | clinusimor 💬 | |
| 2pl | clinudue 💬 | clinusedue 💬 | clinusidue 💬 | |
| 3pl | clinuntor 💬 | clinusontor 💬 | clinusintor 💬 | |
| Futur | 1st | clinasiōr 💬 | - | - |
| 2nd | clinasietār 💬 | - | - | |
| 3rd | clinasietor 💬 | - | - | |
| 1pl | clinasiomor 💬 | - | - | |
| 2pl | clinasiedue 💬 | - | - | |
| 3pl | clinasiontor 💬 | - | - | |
| Imparfait | 1st | clinuman 💬 | - | - |
| 2nd | clinutās 💬 | - | - | |
| 3rd | clinuto 💬 | - | - | |
| 1pl | clinumo 💬 | - | - | |
| 2pl | clinutē 💬 | - | - | |
| 3pl | clinunto 💬 | - | - | |
| Prétérit | 1st | clutos/ā/on immi | clutos/ā/on siū | |
| 2nd | clutos/ā/on ei | clutos/ā/on sies | ||
| 3rd | clutos/ā/on eꟈꟈi | clutos/ā/on siet | ||
| 1pl | clutos/ā/on emos | clutos/ā/on siomos | ||
| 2pl | clutos/ā/on esue | clutos/ā/on siete | ||
| 3pl | clutos/ā/on sent | clutos/ā/on siont | ||
Contrairement à la plupart des langues indo-européennes, les prétérits gaulois se répartissent en plusieurs paradigmes, indépendamment de la classe de conjugaison principale du verbe. Il est généralement facile de déterminer, d'après la terminaison du prétérit de 3e singulier cité dans le lexique, à quel paradigme il appartient. Les prétérits de la voix active sont donnés ci-dessous, à l'aide d'exemples de verbes attestés pour lesquels au moins une forme prétérite est connue, ou le prétérit peut être reconstruit à partir de la racine proto-celtique.
Les prétérits passifs n'ont pas de terminaison propre ; pour de telles significations, utilisez le nombre et le genre correspondants du participe passé (déclinaison O/A) avec la forme correspondante de l'indicatif présent ou du subjonctif présent de eꟈꟈi, e.g. appissā immi j'ai été vu ; auuessā buont ils soient (déjà) faits.
| Verb: appiset, ad-pepise, appissos; pisiū, -onos.: voir | ||||
| Indicatif | Subjonctif | |||
|---|---|---|---|---|
| Singulier | Pluriel | Singulier | Pluriel | |
| 1er | adpepis-a | adpepis-me | adpepis-sīn | adpepis-sīmos |
| 2e | adpepis-as | adpepis-e | adpepis-sīs | adpepis-sīte |
| 3e | adpepis-e | adpepis-ar | adpepis-sīt | adpepis-sīnt |
Ces prétérits se forment en ajoutant -s- à la tige présente.
| Verb: ibet, ixset, ixtos; oclon, -ī: boire | ||||
| Indicatif | Subjonctif | |||
|---|---|---|---|---|
| Singulier | Pluriel | Singulier | Pluriel | |
| 1er | ix-san | ix-same | ix-sīn | ix-sīmos |
| 2e | ix-ses | ix-sate | ix-sīs | ix-sīte |
| 3e | ix-set | ix-sant | ix-sīt | ix-sīnt |
Si le radical se termine par une voyelle, le prétérit prend souvent un préfixe ro- ou re- afin de distinguer la 2e personne du singulier — et plus tard le 3e singulier lorsque ꟈ a commencé à se transformer en > s — du présent.
| Verb: carāt, ro-carāst, carātos; carā, -iās: se soucier | ||||
| Indicatif | Subjonctif | |||
|---|---|---|---|---|
| Singulier | Pluriel | Singulier | Pluriel | |
| 1er | ro-carā-san | ro-carā-sme | ro-carā-sīn | ro-carā-sīmos |
| 2e | ro-carā-ss | ro-carā-ste, carā-ꟈe | ro-carā-sīs | ro-carā-sīte |
| 3e | ro-carā-ꟈ, carā-s | ro-carā-sant | ro-carā-sīt | ro-carā-sīnt |
Le 3e sg. est attesté comme readdas (< ro-addāꟈ) interprété comme signifiant « sacrifié ». Le radical prétérit addās- prend la 3ème terminaison singulière -t, changeant régulièrement en st > ts > ꟈ > s.
| Verb: auuedet, auuōt, auuessos; auuedenā, -iās: faire | ||||||||
| Verb: sagiet, sioxt, saxtos; sagitis, -ēs.: chercher | ||||||||
| Indicatif | Subjonctif | Indicatif | Subjonctif | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Singulier | Pluriel | Singulier | Pluriel | Singulier | Pluriel | Singulier | Pluriel | |
| 1er | auuōd-an | auuōd-mes | auuōꟈ-ꟈīn | auuōꟈ-ꟈīmes | siog-an | siog-ames | siox-sīn | siox-sīmes |
| 2e | auuō-ꟈ | auuō-te | auuōꟈ-ꟈīs | auuōꟈ-ꟈīte | siox-s | siox-te | siox-sīs | siox-sīte |
| 3e | auuō-t | auuō-nt | auuōꟈ-ꟈīt | auuōꟈ-ꟈīnt | siox-t | siog-ar | siox-sīt | siox-sīnt |
La forme attestée comme sioxti se trouve au début d'une clause et se compose de sioxt plus l'enclitique dénué de sens -i, puisqu'un enclitique est normalement requis dans les constructions verbales initiales.
Plusieurs attestations montrent un prétérit singulier se terminant par -ū, pluriel -ūs. Ceci est cohérent avec un ensemble de terminaisons de prétérits verbaux proto-celtiques reconstruites, provenant peut-être à l'origine d'un suffixe pronominal instrumental. Si, hypothétiquement, un prétérit sans suffixe tel que *īeure était suffixé par *īeure-os > *īeuros, son instrumental serait īeurū, ce qui est exactement ce que l'on observe dédicace après dédicace, y compris cet exemple à Alise-Sainte-Reine :
MARTIALIS DANNOTALI IEVRV VCVETE SOSIN CELICNON ETIC GOBEDBI DUGIIONTIIO VCVETIN IN ALESIA
...qu'on peut interpréter comme « Martialis [fils] de Dannotalos présenté-par-lui à Ucuetis cette salle de banquet et aux forgerons qui vénèrent Ucuetis à Alisia.» Ce verbe est également attesté à la première personne du singulier par īeuri et à la troisième personne du pluriel par īourūs.
La terminaison -ū(s) est également attestée par exemple dans carnitū (érigé) et dedū (donné), cependant, comme le prétérit dede est également attesté, -ū ne peut pas être la terminaison normale du prétérit 3e singulier de ce verbe.
Si nous acceptons dedū comme forme de conjugaison alternative de dede, alors les prétérits en U pourraient représenter un ensemble innovant de terminaisons de prétérits appliquées spécifiquement aux verbes de dédicace, avec un paradigme similaire au suivant :
| Verb: ernat, īeurū, rātos ; rātus, -ous | ||||
| Indicatif | Subjonctif | |||
|---|---|---|---|---|
| Singulier | Pluriel | Singulier | Pluriel | |
| 1er | īeuri | īeuramo | īeurasīn | īeurasīmos |
| 2e | īeurūs | īeurate | īeurasīs | īeurasīte |
| 3e | īeurū | īeurūs | īeurasīt | īeurasīnt |
Le parfait est formé en préfixant ro- au présent ou au prétérit. Le futur antérieur se forme en préfixant ro- au subjonctif présent.
Les langues celtiques diffèrent dans la formation des participes, notamment au présent. Dans les langues modernes, il est courant d'utiliser une terminaison comme -te ou -ta pour le participe présent. En gaulois, deux nominalisateurs et un suffixe agentif sont attestés, et chaque verbe possède son propre participe passé, qui sert également à former la voix passive du passé, comme nous faisons en fran¸ais (par exemple, « je suis arrivé(e) »).
Les formes nominales des verbes peuvent être formées directement à partir de la forme du dictionnaire. Le suffixe -os a un sens actif, et le suffixe -ios un sens inactif.
Tous ces formes nominales prennent des terminaisons -os, -ā, -on qui se déclinent comme les adjectifs O/A.
Le suffixe -os est également attesté dans la déclinaison I dans le cas de l'accusatif arueriíātin, qui signifie « celui qui donne satisfaction ». Cette terminaison pourrait donner un sens à la forme plurielle eurisēs (offrants) si elle est le pluriel de *eurisis, une forme suffixée dérivée du même verbe que īeurū (voir la section sur les prétérits pour plus d'informations sur ce verbe).
Il y'a égalment un suffixe agentif -aunos/ā/on.
Comme le gaulois semble avoir transformé ses participes présents en noms, il se peut qu'il n'ait pas de participe présent véritable, exprimant plutôt ces significations par des constructions « ce qui… », comme dans longos monīt-io litt. « le bateau qui s'approche » (io = « cela », relatif) pour signifier « le bateau approchant », puisque longos moniaunos signifierait quelque chose comme « le bateau appelé L'Approchant ».
Chaque verbe est répertorié dans le lexique avec un participe passé. Cela constitue la base des participes passifs avec des significations imperfectives, perfectives ou futures.
Certains verbes ont un participe passé dans le dictionnaire qui est le même que ce que produirait le nominaliseur actif, par exemple damāt « endurer », au passé damātos « enduré ». Dans ce cas, la forme nominale active **damāt-os (**« endureur ») n'est pas utilisée, mais l'agentif est disponible de prendre sa place, par exemple damaunos « endureur ».
La forme se terminant par -innos est une sorte de participe intentionnel passif. Certaines sources le qualifient de gérondif, ce qui prête à confusion, même si le mot gérondif a généralement une signification totalement différente. Le verbe eꟈꟈi, « être », n'a pas de participe passif ; son intentionnel passif est donc onnos. Également attesté avec le même sens est -teios, mais il n'est pas certain qu'il s'agisse d'un emprunt au grec.
Il existe peu de documents attestant de la manière dont le gaulois forme les énoncés de nécessité, et les langues celtiques actuelles ont des manières divergentes de l'exprimer. Cependant, le goïdélique et le brittonique possèdent des constructions qui pourraient être traduites par « il est sur [un] à… », plus précisément l'irlandais bí ar correspondant à Gaul. *butā uer et l'occidental gorfod correspondant à Gaul. *uer-butā. Il est donc fort probable que le gaulois possède lui aussi une construction signifiant « il est sur [pronom] à… » incluant uer, eꟈꟈi, et un nom verbal. C'est comparable à l'anglais « have to » et à l'espagnol « tener que » dans le sens où l'on dit que l'action est faite par celui qui doit l'accomplir.
La reconstruction la plus parcimonieuse pour ce style de phrasé serait eꟈꟈi uer me/te/eíī/eiū + vn., par exemple:
CIl existe un suffixe de nécessité -teios, que certaines sources qualifient de « gérondif », mais ce n'est pas le sens du mot gérondif, et on ne sait pas si ce suffixe est gaulois ou s'il s'agit d'un emprunt au grec -τέος. Ce suffixe ne semble pas apparaître dans d'autres langues celtiques.
L'inscription de Châteaubleau comporte un mot ueíonna qui a été interprété comme « se marier », peut-être uei- « se marier » + onnā, ce dernier composant étant supposé être le « gérondif » de eꟈꟈi. On trouve également dans le même texte iegiíinna, qui signifierait « être appelé ». Sur la base de ces deux formes dans cette inscription unique, il est plausible qu'un suffixe -íinnos existe en gaulois, dont la fonction grammaticale pourrait raisonnablement être qualifiée de suffixe intentionnel passif des verbes, et que l'intentionnel passif de eꟈꟈi soit onnos. Le sens de « se marier » est confirmé ailleurs par une autre attestation ueíobiu : « je me marierai » ou, plus probablement pour des raisons morphologiques, « je me marierais » (dans ce cas, vraisemblablement en demandant la permission).
D'autres auteurs affirment que l'adjectif rincitusos, ou une variante de celui-ci, est un équivalent direct de l'anglais need, puis utilisent la forme verbale rinci- comme expression par défaut pour exprimer tous les types de nécessité. Cependant, ils utilisent une expression très germanique, devenue courante ces derniers siècles, que l'on ne trouve ni dans les langues anciennes ni dans les langues celtiques, et l'imposent de manière incongrue à une langue où elle n'a pas sa place. Nous pouvons donc être certains que les anciens Gaulois n'ont jamais utilisé rinci- comme expression par défaut pour exprimer la nécessité.
| Actif | Moyenne | |||
|---|---|---|---|---|
| Indicatif | Subjonctif | Optatif | ||
| Présent | 1st | tēgū 💬 | tēxsū 💬 | tēxsiōr 💬 |
| 2nd | tēges 💬 | tēxses 💬 | tēxsitār 💬 | |
| 3rd | tēget 💬 | tēxset 💬 | tēxsitor 💬 | |
| 1pl | tēgomos 💬 | tēxsomos 💬 | tēxsimor 💬 | |
| 2pl | tēgete 💬 | tēxsete 💬 | tēxsidue 💬 | |
| 3pl | tēgont 💬 | tēxsont 💬 | tēxsintor 💬 | |
| Futur | 1st | rigāsū 💬 | - | - |
| 2nd | rigāses 💬 | - | - | |
| 3rd | rigāset 💬 | - | - | |
| 1pl | rigāsomos 💬 | - | - | |
| 2pl | rigāsete 💬 | - | - | |
| 3pl | rigāsont 💬 | - | - | |
| Imparfait | 1st | tēgeman 💬 | - | - |
| 2nd | tēgetās 💬 | - | - | |
| 3rd | tēgeto 💬 | - | - | |
| 1pl | tēgemo 💬 | - | - | |
| 2pl | tēgetē 💬 | - | - | |
| 3pl | tēgento 💬 | - | - | |
| Prétérit | 1st | ludū 💬 | ellū 💬 | - |
| 2nd | ludes 💬 | elles 💬 | - | |
| 3rd | ludet 💬 | ellet 💬 | - | |
| 1pl | ludomos 💬 | ellomos 💬 | - | |
| 2pl | ludete 💬 | ellete 💬 | - | |
| 3pl | ludont 💬 | ellont 💬 | - | |
| Imparfaitif | Aoriste | |||
| Impératif | 1st | - | - | |
| 2nd | tēge 💬 | lūꟈ 💬 | ||
| 3rd | tēgetū 💬 | lūꟈtū 💬 | ||
| 1pl | tēgomo 💬 | lūꟈomo 💬 | ||
| 2pl | tēgetes 💬 | lūꟈetes 💬 | ||
| 3pl | tēgontū 💬 | lūꟈontū 💬 | ||
| Actif | Moyenne | Passif | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicatif | Subjonctif | Optatif | Indicatif | Subjonctif | ||
| Présent | 1st | gniíū 💬 | gniísū 💬 | gniísiōr 💬 | gniíōr 💬 | gniísōr 💬 |
| 2nd | gniíes 💬 | gniíses 💬 | gniísitār 💬 | gniíetār 💬 | gniísetār 💬 | |
| 3rd | gniíet 💬 | gniíset 💬 | gniísitor 💬 | gniíetor 💬 | gniísetor 💬 | |
| 1pl | gniíomos 💬 | gniísomos 💬 | gniísimor 💬 | gniíomor 💬 | gniísomor 💬 | |
| 2pl | gniíete 💬 | gniísete 💬 | gniísidue 💬 | gniíedue 💬 | gniísedue 💬 | |
| 3pl | gniíont 💬 | gniísont 💬 | gniísintor 💬 | gniíontor 💬 | gniísontor 💬 | |
| Futur | 1st | gniísiū 💬 | - | - | gniísiōr 💬 | - |
| 2nd | gniísies 💬 | - | - | gniísietār 💬 | - | |
| 3rd | gniísiet 💬 | - | - | gniísietor 💬 | - | |
| 1pl | gniísiomos 💬 | - | - | gniísiomor 💬 | - | |
| 2pl | gniísiete 💬 | - | - | gniísiedue 💬 | - | |
| 3pl | gniísiont 💬 | - | - | gniísiontor 💬 | - | |
| Imparfait | 1st | gniíeman 💬 | - | - | gniíemar 💬 | - |
| 2nd | gniíetās 💬 | - | - | gniíetār 💬 | - | |
| 3rd | gniíeto 💬 | - | - | gniíetor 💬 | - | |
| 1pl | gniíemo 💬 | - | - | gniíemor 💬 | - | |
| 2pl | gniíetē 💬 | - | - | gniíeduē 💬 | - | |
| 3pl | gniíento 💬 | - | - | gniíentor 💬 | - | |
| Prétérit | 1st | au-uōmi 💬 | au-usīn 💬 | - | auuessos/ā/on immi | auuessos/ā/on siū |
| 2nd | au-uōs 💬 | au-usīs 💬 | - | auuessos/ā/on ei | auuessos/ā/on sies | |
| 3rd | au-uōt 💬 | au-usīt 💬 | - | auuessos/ā/on eꟈꟈi | auuessos/ā/on siet | |
| 1pl | au-uōme 💬 | au-usīmos 💬 | - | auuessos/ā/on emos | auuessos/ā/on siomos | |
| 2pl | au-uōte 💬 | au-usīte 💬 | - | auuessos/ā/on esue | auuessos/ā/on siete | |
| 3pl | au-uōnt 💬 | au-usīnt 💬 | - | auuessos/ā/on sent | auuessos/ā/on siont | |
| Imparfaitif | Aoriste | |||||
| Impératif | 1st | - | - | |||
| 2nd | gniíe 💬 | au-uas 💬 | ||||
| 3rd | gniíetū 💬 | au-uastū 💬 | ||||
| 1pl | gniíomo 💬 | au-uasomo 💬 | ||||
| 2pl | gniíetes 💬 | au-uasetes 💬 | ||||
| 3pl | gniíontū 💬 | au-uasontū 💬 | ||||
| Actif | Moyenne | |||
|---|---|---|---|---|
| Indicatif | Subjonctif | Optatif | ||
| Présent | 1st | immi 💬 | siíū 💬 | beíiassū 💬 |
| 2nd | ei 💬 | siíes 💬 | beíiasses 💬 | |
| 3rd | eꟈꟈi 💬 | siíet 💬 | beíiasset 💬 | |
| 1pl | emos 💬 | siíomos 💬 | beíiassomos 💬 | |
| 2pl | esue 💬 | siíete 💬 | beíiassete 💬 | |
| 3pl | sent 💬 | siíont 💬 | beíiassont 💬 | |
| Futur | 1st | bissiū 💬 | - | - |
| 2nd | bissies 💬 | - | - | |
| 3rd | bissiet 💬 | - | - | |
| 1pl | bissiomos 💬 | - | - | |
| 2pl | bissiete 💬 | - | - | |
| 3pl | bissiont 💬 | - | - | |
| Imparfait | 1st | eiāman 💬 | - | - |
| 2nd | eiātās 💬 | - | - | |
| 3rd | eiāto 💬 | - | - | |
| 1pl | eiāmo 💬 | - | - | |
| 2pl | eiātē 💬 | - | - | |
| 3pl | eiānto 💬 | - | - | |
| Imparfaitif | Aoriste | |||
| Impératif | 1st | - | - | |
| 2nd | biíe 💬 | - | ||
| 3rd | biíetū 💬 | - | ||
| 1pl | biíomo 💬 | - | ||
| 2pl | biíetes 💬 | - | ||
| 3pl | biíontū 💬 | - | ||
Ce verbe signifie également « exister », et le sens de « avoir » est exprimé avec une modification de celui-ci :
| Singulier | Pluriel | |
|---|---|---|
| 1er | mīeꟈi | nīseꟈi, nīeꟈi |
| 2e | tīeꟈi | suīeꟈi |
| 3e f. | sīeꟈi | iāeꟈi |
| 3e m. | iseꟈi | ēieꟈi |
| 3e n. | ideꟈi | īeꟈi |
Toutes les autres formes de la troisième personne de eꟈꟈi, au singulier comme au pluriel, peuvent être utilisées dans cette même manière, par exemple mīsenti, tīsiet, nīsbissiont, etc.
| Déposant | Moyenne | |||
|---|---|---|---|---|
| Indicatif | Subjonctif | Optatif | ||
| Présent | 1st | uidra 💬 | uidrsū 💬 | uidrsiōr 💬 |
| 2nd | uidras 💬 | uidrses 💬 | uidrsitār 💬 | |
| 3rd | uidre 💬 | uidrset 💬 | uidrsitor 💬 | |
| 1pl | uidramo 💬 | uidrsomos 💬 | uidrsimor 💬 | |
| 2pl | uidrate 💬 | uidrsete 💬 | uidrsidue 💬 | |
| 3pl | uidrar 💬 | uidrsont 💬 | uidrsintor 💬 | |
| Futur | 1st | uidrsiōr 💬 | - | - |
| 2nd | uidrsietār 💬 | - | - | |
| 3rd | uidrsietor 💬 | - | - | |
| 1pl | uidrsiomor 💬 | - | - | |
| 2pl | uidrsiedue 💬 | - | - | |
| 3pl | uidrsiontor 💬 | - | - | |
| Imparfait | 1st | uidremar 💬 | - | - |
| 2nd | uidretār 💬 | - | - | |
| 3rd | uidretor 💬 | - | - | |
| 1pl | uidremor 💬 | - | - | |
| 2pl | uidreduē 💬 | - | - | |
| 3pl | uidrentor 💬 | - | - | |
| Prétérit | 1st | uidrtos/ā/on immi | uidrtos/ā/on siū | |
| 2nd | uidrtos/ā/on ei | uidrtos/ā/on sies | ||
| 3rd | uidrtos/ā/on eꟈꟈi | uidrtos/ā/on siet | ||
| 1pl | uidrtos/ā/on emos | uidrtos/ā/on siomos | ||
| 2pl | uidrtos/ā/on esue | uidrtos/ā/on siete | ||
| 3pl | uidrtos/ā/on sent | uidrtos/ā/on siont | ||
Les conditionnels peuvent également mélanger les temps, par exemple :
mā depretās-tū tuon melissobargon • ne gallases petidion rīs ērū
Les cardinaux un à quatre s'accordent avec le genre et le cas de leurs noms, par exemple : tidres suiores « trois sœurs ». D'autres cardinaux prennent le génitif pluriel, par exemple : sextan blēdnānon « sept ans », littéralement « sept années ». Les ordinaux et les multiplicatifs se déclinent comme les adjectifs O/A ; cintus est un adjectif radical en U qui a une forme alternative O/A : cintuxos.
| Cardinal | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | f. | m. | n. | Ordinal | Adverbe | Multiplicatif | Fractive | Collectif |
| 1 | oinā | oinos | oinon | cintus, -u | smīs | oinouellos, -ā, -on | cantos | donios |
| 2 | duī | duo | allos, -ā, -on | duīs | duīuellos, -ā, -on | letos, santeron | ambostā | |
| 3 | tidres | trīs | trī | tritos, -ā, -on | trīuextā | trīuellos, -ā, -on | triíanis | tridion |
| 4 | petedres | petuares | petuār | petuarios, -ā, -on | petruuextā | petruuellos, -ā, -on | petranis | petrudion |
| 5 | pempe | pimpetos, -ā, -on | pimpeuextā | pimpeuellos, -ā, -on | pimpanis | pimpedion | ||
| 6 | suexs | suexos, -ā, -on | suexuextā | suexsuellos, -ā, -on | suexsanis | suedion | ||
| 7 | sextan | sextametos, -ā, -on | sextauextā | sextauellos, -ā, -on | sextanis | sextanion | ||
| 8 | oxtū | oxtūmetos, -ā, -on | oxtūuextā | oxtūuellos, -ā, -on | oxtūuanis | oxtūdion | ||
| 9 | nauan | nametos, -ā, -on | nauuextā | nauuellos, -ā, -on | nauanis | nauantion | ||
| 10 | decan | decametos, -ā, -on | decuextā | decauellos, -ā, -on | decanis | decantion | ||
| 11 | oindecan | oindecametos, -ā, -on | oindecuextā | oindecauellos, -ā, -on | oindecanis | oindecantion | ||
| 12 | duodecan | duodecametos, -ā, -on | duodecuextā | duodecauellos, -ā, -on | duodecanis | duodecantion | ||
| 13 | trīdecan | trīdecametos, -ā, -on | trīdecuextā | trīdecauellos, -ā, -on | trīdecanis | trīdecantion | ||
| 14 | petrudecan | petrudecametos, -ā, -on | petrudecuextā | petrudecauellos, -ā, -on | petrudecanis | petrudecantion | ||
| 15 | pimpedecan | pimpedecametos, -ā, -on | pimpedecuextā | pimpedecauellos, -ā, -on | pimpedecanis | pimpedecantion | ||
| 16 | suedecan | suedecametos, -ā, -on | suedecuextā | suedecauellos, -ā, -on | suedecanis | suedecantion | ||
| 17 | sextadecan | sextadecametos, -ā, -on | sextadecuextā | sextadecauellos, -ā, -on | sextadecanis | sextadecantion | ||
| 18 | oxtūdecan | oxtūdecametos, -ā, -on | oxtūdecuextā | oxtūdecauellos, -ā, -on | oxtūdecanis | oxtūdecantion | ||
| 19 | naudecan | naudecametos, -ā, -on | naudecuextā | naudecauellos, -ā, -on | naudecanis | naudecantion | ||
Le nombre un se décline comme un adjectif O/A normal. Les nombres deux à quatre ont leurs propres déclinaisons :
| Deux | Trois | Quatre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. | M/N. | F. | M. | N. | F. | M. | N. | |
| Nom. | duī | duo | tidres | trīs | trī | petedres | petuares | petuār |
| Voc. | duī | duo | tidre | trīe | trī | petedre | petuare | petuār |
| Acc. | duī | duo | tidrās | trīs | trī | petedrās | peturīs | petuār |
| Gen. | duiíou | duiíou | tidron | trīon | trīon | petedron | peturon | peturon |
| Dat. | duibon | duibon | tidrobo | trīobo | trīobo | petedrobo | peturobo | peturobo |
| I/L. | duibin | duibin | tidrobi | trīobi | trīobi | petedrobi | peturobi | peturobi |
Les féminins des nombres 3 et 4 descendent du proto-celtique *tisres et *petesres, mais le féminin du 3 est attesté en gaulois sous la forme tidres. Comme on pense que le groupe consonantique sr sonnait comme /θr/, on comprend aisément comment ce son a pu être écrit et prononcé dr. La façon dont il est « correct » dépend probablement de l'époque et du lieu, mais il est plus logique de se fier à la forme attestée.
Les terminaisons -ā, -on sont omises du tableau ci-dessous par souci de concision, mais les ordinaux et les multiplicatifs, ainsi que le cardinal oinos, continuent tous à se décliner comme les adjectifs O/A. uicantī se comporte comme un nom de déclinaison A, décliné comme blednī ; les autres multiples de dix ne sont attestés qu'avec une terminaison latinisée en -contis, mais selon Delamarre, ceux-ci se terminaient probablement à l'origine par -conta ou -conti. Il est raisonnable de supposer qu'il s'agissait également de déclinaisons A en -ī. Les nombres de 5 à 20, 25 à 30, 35 à 40, etc., prennent le génitif pluriel de la chose comptée, par exemple trīcontī danton trente dents, oxtūcontīn cingeton quatre-vingts soldats (acc.), etc.
| # | Cardinal | Ordinal | Adverbe | Multiplicatif | Fractive | Collectif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | uicantī | uicantometos | uicantouextā | uicantouellos | uicantanis | uicantion |
| 21 | uicantī oinos | uicantometos cintus | oinuicantouextā | uicantouellos oinouellos | oinuicantanis | oinuicantion |
| 30 | trīcontī | trīcontometos | trīcontouextā | trīcontouellos | trīcontanis | trīcontion |
| 40 | petrucontī | petrucontometos | petrucontouextā | petrucontouellos | petrucontanis | petrucontion |
| 50 | pimpecontī | pimpecontometos | pimpecontouextā | pimpecontouellos | pimpecontanis | pimpecontion |
| 60 | suescontī | suescontometos | suescontouextā | suescontouellos | suescontanis | suescontion |
| 70 | sextacontī | sextacontometos | sextacontouextā | sextacontouellos | sextacontanis | sextacontion |
| 80 | oxtūcontī | oxtūcontometos | oxtūcontouextā | oxtūcontouellos | oxtūcontanis | oxtūcontion |
| 90 | naucontī | naucontometos | naucontouextā | naucontouellos | naucontanis | naucontion |
| 100 | canton | cantometos | cantouextā | cantouellos | cantanis | cantoion |
| 101 | canton oinos | cantometos cintus | oincantouextā | cantouellos oinouellos | oincantanis | oincantoion |
| 200 | duocanton | duocantometos | duocantouextā | duocantouellos | duocantanis | duocantoion |
| 1000 | mīlle | mīllometos | mīllouextā | mīllouellos | mīllanis | mīlloion |
Le mot mílle est un emprunt au latin. Toutes les langues celtiques modernes empruntent une forme de ce mot pour « mille », et le gaulois a probablement fait de même. Il existe un mot hypothétique, **gellon, signifiant « mille », mais son étymologie est douteuse, car la racine indo-européenne *ǵʰeslom n'est pas attestée en celtique. Une reconstruction plus probable pourrait être **tūscanton, de l'indo-européen *tuh₂sdḱmto-, ayant des équivalents en germanique et en balto-slave, mais cette racine n'est également attestée nulle part dans les langues celtiques.
Les nombres de 30 à 99 ont un système vigésimal optionnel en plus du système décimal plus courant, par exemple petedres uicantiās, directement équivalent à « quatre-vingts ». Le nombre uicantī, vingt, est grammaticalement un nom féminin de la déclinaison A. Il apparaît au duel dans les nombres vigésimaux 40 et 50, et au pluriel dans les nombres vigésimaux 60-90.
| # | Cardinal | Ordinal | Adverbe | Multiplicatif | Fractive | Collectif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | uicantī decan | uicantometos decametos | uicantouextā decuextā | uicantouellos decauellos | uicantanis decanis | uicantion decantion |
| 40 | duī uicantī | duī uicantometos | duī uicantouextā | duī uicantouellos | duī uicantanis | duī uicantion |
| 50 | duī uicantī decan | duī uicantometos decametos | duī uicantouextā decuextā | duī uicantouellos decauellos | duī uicantanis decanis | duī uicantion decantion |
| 60 | tidres uicantiās | t. uicantometos | t. uicantouextā | t. uicantouellos | t. uicantanis | t. uicantion |
| 70 | tidres uicantiās decan | t. uicantometos decametos | t. uicantouextā decuextā | t. uicantouellos decauellos | t. uicantanis decanis | t. uicantion decantion |
| 80 | petedres uicantiās | p. uicantometos | p. uicantouextā | p. uicantouellos | p. uicantanis | p. uicantion |
| 90 | petedres uicantiās decan | p. uicantometos decametos | p. uicantouextā decuextā | p. uicantouellos decauellos | p. uicantanis decanis | p. uicantion decantion |
L'ordre des mots neutre, non marqué et non emphatique est :
Sujet, Verbe, Complément d'Objet Indirect/Oblique, Complément d'Objet Direct Prédicatif, Adjonction, Source/But/Destination, Complément d'Objet Direct Attributif. Exemple de phrase, décomposée par structure:
| rīxs | sujet | le roi |
| ro-dede | verbe | a donné |
| sue-duxtrē | objet indirect | sa fille |
| epon | objet direct predicatif | un cheval |
| eri ne sī-eiāto epos | adjonction | parce qu'elle n'avait pas de cheval |
| uta gallaset-sī tixtin endo ueletor-io | but | pour qu'elle puisse aller où elle voulait |
| nertomāron | objet direct attributif | un puissant |
L'ordre des mots SVO est le plus courant dans les propositions principales. L'ordre VSO est courant dans les propositions subordonnées:
mātīr tuā ro-dede tei sondīn malenin
Ta mère t'a donné ce miroir.
an sondiā eꟈꟈi malenā ro-dede-io mātīr tuā tei ?
Est-ce le miroir que ta mère t’a donné ?
Lorsque l'ordre VSO est utilisé dans une proposition principale, avec le verbe en premier, il met l'accent sur le verbe et peut signifier qu'une action s'est produite soudainement, ou à la suite d'actions ou de conditions antérieures, etc. Les impératifs et les contrastifs sont généralement VSO.
uourū catuslougos catulisson nāmanton • sepans sagitē cēnī
[Soudain], la troupe trouva le camp ennemi, après une longue recherche.
(Prenez nāmanton
comme génitif pluriel qualifiant l'accusatif catulisson.)
ateelsintor-is moi carantes ciē moxs
Que mes amis reviennent et me rendent visite bientôt.
L'ordre SOV est également connu, avec le verbe last. Il possède une qualité poétique classique, comme s'il s'agissait d'un discours ancien.
Uercingetorīxs canti Caesari inte nertācon iexset
Vercingétorix avec César parla courageusement.
Lorsque les formes de eꟈꟈi sont utilisées pour signifier « avoir », le datif du sujet précède souvent directement le verbe. Ceci est attesté sous une forme réduite : tīeꟈi, « tu as », de tei eꟈꟈi, litt. « il y a pour toi ». D'autres personnes et nombres tels que mīeꟈi et suīeꟈi sont possibles, tout comme les formes avec sent (signifiant que plusieurs choses sont possédées) au lieu de eꟈꟈi.
L'ordre habituel est que l'adjectif suive le nom, surtout s'il est plus pertinent ou plus important que le nom, et/ou s'il décrit une qualité intrinsèque du nom, comme son origine, sa composition, etc. Dans de nombreuses expressions courantes, l'adjectif suit toujours le nom.
Les adjectifs de qualité, quantité, ou de taille, tels que ollos, allos, pāpos, magios, elus, māros, précèdent généralement le nom, mais s'ils le suivent, ils ont un sens indéfini. L'adjectif nepos appartient à cette classe, mais il suit le nom car il est indéfini par définition.
Un adjectif qui suivrait normalement le nom peut le précéder à des fins de contraste, par exemple an dagon menman eꟈꟈi an drucon ?, « est-ce une bonne ou une mauvaise idée ? ».
L'ordre normal des adjectifs empilés consiste à placer les attributs intrinsèques ou inaliénables de l'essence plus près du nom que les adjectifs désignant des attributs temporaires ou mutables du statut.
Les démonstratifs précèdent généralement le nom. Le démonstratif eiā (f.), is (m.), id (n.) peuvent faire référence à un nom antérieur de la même manière que l'on dit « le susdit ».
Les chiffres précèdent généralement le nom, mais peuvent le suivre pour souligner le nombre.
Les génitifs, ou datifs d'appartenance, suivent normalement le nom, par exemple toutius Nemausī citoyen de Nîmes, caranꟈ uenīās ami de la famille.
Les possessifs mos, monī, mon précèdent toujours le nom, tandis que īmos, īmī, īmon suivent toujours le nom, et tuos, tuā, tuon peuvent précéder ou suivre.
Les partitifs suivent le nom principal. Les génitifs ou possessifs apparaissent souvent entre le nom principal et un adjectif, par exemple genetā īmī dagā uimpī
Les chansons sont un excellent moyen d'apprendre une langue. Une technique consiste à prendre une chanson familière et, tout en la chantant, à remplacer progressivement des mots de la langue d'origine par des mots de la langue cible jusqu'à ce que tous les mots soient traduits. Cela nécessite une chanson avec des refrains répétitifs, ce qui est heureusement courant dans les chansons pour enfants. Un autre avantage est que les structures de phrases sont plus simples, sans trop de sous-texte et se concentrent sur le sens des mots plutôt que sur la complexité de l'état émotionnel de l'auteur. Ces chansons sont conçues pour l'apprentissage, et elles font partie intégrante de l'apprentissage de notre langue maternelle ; il est donc logique de les inclure dans l'apprentissage d'une deuxième langue.
Cette version diffère de l'originale par la formulation du mot « plumerai » ; alors que le mot original désigne spécifiquement le fait d'arracher des plumes, les langues celtiques utilisent généralement un mot signifiant « arracher », ou un emprunt à l'anglais ou au latin, pour désigner le plumer. Il est donc nécessaire en gaulois de préciser que les choses arrachées sont des plumes.
Le sens de gabiet (fut. gaxsiet) est plus proche de « prendre » ou « tenir », mais certains termes apparentés modernes suggèrent que gabiet est le verbe correct pour cette chanson. Le seul autre mot gaulois similaire est tenet, qui signifie plutôt « étirer ». Par ailleurs, les utilisations attestées de la forme impérative gabi sont certainement cohérentes avec le sens d'« arracher ».
ā alauda, blanda a alauda
gaxsiū-mī tuās ataniās
ataniās au pennū
ataniās au pennū
eti pennū eti pennū
alauda alauda
āā-āā-āā-ā
ā alauda, blanda a alauda
gaxsiū-mī tuās ataniās
ataniās au gobbū
ataniās au gobbū
eti gobbū eti gobbū
eti pennū eti pennū
alauda alauda
āā-āā-āā-ā
ā alauda, blanda a alauda
gaxsiū-mī tuās ataniās
ataniās au dercobi
ataniās au dercobi
eti dercobi eti dercobi
eti gobbū eti gobbū
eti pennū eti pennū
alauda alauda
āā-āā-āā-ā
ā alauda, blanda a alauda
gaxsiū-mī tuās ataniās
ataniās au moniclū
ataniās au moniclū
eti moniclū eti moniclū
eti dercobi eti dercobi
eti gobbū eti gobbū
eti pennū eti pennū
alauda alauda
āā-āā-āā-ā
ā alauda, blanda a alauda
gaxsiū-mī tuās ataniās
ataniās au dousandbi
ataniās au dousandbi
eti dousandbi eti dousandbi
eti moniclū eti moniclū
eti dercobi eti dercobi
eti gobbū eti gobbū
eti pennū eti pennū
alauda alauda
āā-āā-āā-ā
ā alauda, blanda a alauda
gaxsiū-mī tuās ataniās
ataniās au garrābi
ataniās au garrābi
eti garrābi eti garrābi
eti dousandbi eti dousandbi
eti moniclū eti moniclū
eti dercobi eti dercobi
eti gobbū eti gobbū
eti pennū eti pennū
alauda alauda
āā-āā-āā-ā
ā alauda, blanda a alauda
gaxsiū-mī tuās ataniās
ataniās au lostū
ataniās au lostū
eti lostū eti lostū
eti garrābi eti garrābi
eti dousandbi eti dousandbi
eti moniclū eti moniclū
eti dercobi eti dercobi
eti gobbū eti gobbū
eti pennū eti pennū
alauda alauda
āā-āā-āā-ā
ā alauda, blanda a alauda
gaxsiū-mī tuās ataniās
ataniās au cebenū
ataniās au cebenū
eti cebenū eti cebenū
eti lostū eti lostū
eti garrābi eti garrābi
eti dousandbi eti dousandbi
eti moniclū eti moniclū
eti dercobi eti dercobi
eti gobbū eti gobbū
eti pennū eti pennū
alauda alauda
āā-āā-āā-ā
ā alauda, blanda a alauda
gaxsiū-mī tuās ataniās
Dunniū senū eiāto steros
in biutūti ulatēs
sondiē sterē eiāto epos
in biutūti ulatēs
eti ciē ririri
eti endo ririri
elu ririri
Dunniū senū eiāto steros
in biutūti ulatēs
sondiē sterē eiāto cū
in biutūti ulatēs
eti ciē rourou
eti endo rourou
elu rourou
Dunniū senū eiāto steros
in biutūti ulatēs
sondiē sterē eiāto iaros
in biutūti ulatēs
eti ciē clociā
eti endo clociā
elu clociā
Dunniū senū eiāto steros
in biutūti ulatēs
sondiē sterē eiāto gansos
in biutūti ulatēs
eti ciē on-on
eti endo on-on
elu on-on
Dunniū senū eiāto steros
in biutūti ulatēs
sondiē sterē eiāto bous
in biutūti ulatēs
eti ciē mū-mū
eti endo mū-mū
elu mū-mū
Dunniū senū eiāto steros
in biutūti ulatēs
sondiē sterē eiāto moccos
in biutūti ulatēs
eti ciē suīx-suī
eti endo suīx-suī
elu suīx-suī
Dunniū senū eiāto steros
in biutūti ulatēs
sondiē sterē eiāto cattos
in biutūti ulatēs
eti ciē miū-miū
eti endo miū-miū
elu miū-miū
Dunniū senū eiāto steros
in biutūti ulatēs
sondiē sterē eiāto multū
in biutūti ulatēs
eti ciē bēa-bēa
eti endo bēa-bēa
elu bēa-bēa
Dunniū senū eiāto steros
in biutūti ulatēs
sondiē sterē eiāto burdus
in biutūti ulatēs
eti ciē īī-āā
eti endo īī-āā
elu īī-āā
Dunniū senū eiāto steros
in biutūti ulatēs
sondiē sterē eiāto craxsantos
in biutūti ulatēs
eti ciē ric-cic ric-cic
eti endo ric-cic ric-cic
elu ric-cic ric-cic
Dunniū senū eiāto steros
in biutūti ulatēs
supennoblēdnī
supennoblēdnī
sucare caranꟈ
supennoblēdnī
Si le destinataire est une femme, utilisez sucara à la troisième ligne. On remplace normalement caranꟈ par le nom de la personne, au vocatif si possible.
legus meios corrinios uer beccon dubrī rext
uo cice unnā eti nenoiue corrinion
sonnos eialle etic auuōt unnin tartin
legus-c meios corrinios uer beccon ate rext
Ceci est strictement réservé aux adultes.
Je vous présente… une chanson à boire gauloise ! Ses paroles sont en grande partie tirées d'inscriptions réelles. Malheureusement, le synthétiseur vocal ne peut pas reproduire les rythmes des chansons, mais la partition, avec des paroles en gaulois ancien et tardif, est disponible aux formats PDF et MuseScore.
Je tiens les boissons des proches, des proches
Je tiens les boissons des proches, des proches
Goûte/apprécie le whisky, au goût très prononcé
Buvez*-en et vous soyez joyeux
Goûte/apprécie le whisky, au goût très prononcé
Buvez-en et vous soyez joyeux
Je tiens les boissons des proches, des proches
Je tiens les boissons des proches, des proches
Goûte/apprécie l'hydromel, jaune miel et sucré
Buvez-en et vous soyez joyeux
Goûte/apprécie l'hydromel, mais n'en buvez pas trop**
Buvez-en et vous soyez joyeux
Je tiens les boissons des proches, des proches
Je tiens les boissons des proches, des proches
Goûte/apprécie du vin, rouge ou blanc
Buvez-en et vous soyez joyeux
Goûte/apprécie du vin, rouge ou blanc
Buvez-en et vous soyez joyeux
Je tiens les boissons des proches, des proches
Je tiens les boissons des proches, des proches
Goûte/apprécie de la bière, claire-brune et pétillante
Buvez-en et vous soyez joyeux
Goûte/apprécie de la bière, claire-brune et pétillante
Buvez-en et vous soyez joyeux
Je tiens les boissons des proches, des proches
Je tiens les boissons des proches, des proches
Je tiens les boissons des proches, des proches
Je tiens les boissons des proches, des proches
neꟈꟈamon neꟈꟈamon delgū lindā
neꟈꟈamon neꟈꟈamon delgū lindā
lubī onobiíin ollū ocelācin
ibetes u-ciū andecarī biíetes
lubī onobiíin ollū ocelācin
ibetes u-ciū andecarī biíetes
neꟈꟈamon neꟈꟈamon delgū lindā
neꟈꟈamon neꟈꟈamon delgū lindā
lubī medu melinon meliꟈꟈon
ibetes u-ciū andecarī biíetes
lubī medu exso ni abrū ibe
ibetes u-ciū andecarī biíetes
neꟈꟈamon neꟈꟈamon delgū lindā
neꟈꟈamon neꟈꟈamon delgū lindā
lubī uīnon roudon ixse uindon
ibetes u-ciū andecarī biíetes
lubī uīnon roudon ixse uindon
ibetes u-ciū andecarī biíetes
neꟈꟈamon neꟈꟈamon delgū lindā
neꟈꟈamon neꟈꟈamon delgū lindā
lubī curmi giluon galīaunon
ibetes u-ciū andecarī biíetes
lubī curmi giluon galīaunon
ibetes u-ciū andecarī biíetes
neꟈꟈamon neꟈꟈamon delgū lindā
neꟈꟈamon neꟈꟈamon delgū lindā
neꟈꟈamon neꟈꟈamon delgū lindā
neꟈꟈamon neꟈꟈamon delgū lindā
*Contrairement au français, il n'y a pas de distinction T-V en gaulois, donc l'utilisation des formes « vous » ici ne doit pas être interprétée comme un marqueur de politesse mais strictement comme un pluriel.
**Le mot medu signifie hydromel, mais peut aussi signifier ivresse. Il s'agit donc d'un jeu de mots : « Savourez l'hydromel, mais n'en buvez pas trop » ou « Goûtez l'ivresse, mais n'en buvez pas trop ».
Lorsque j'ai commencé à apprendre le gaulois, j'ai demandé si je pouvais éventuellement mettre en place une interprétation moderne du calendrier de Coligny sur mon site Web, si quelqu'un pouvait m'indiquer la bonne direction sur le fonctionnement de l'ancien calendrier. Ce que j'ai reçu, c'est une réponse durement formulée, selon laquelle il y aurait de graves conséquences si je faisais autre chose que contacter des personnes spécifiques afin d'utiliser une version moderne protégée par le droit d'auteur. J'ai rapidement laissé tomber le sujet et me suis assuré de ne plus jamais en parler. Finalement, j'ai fini par trouver la réponse que je cherchais en premier lieu, ainsi qu'une photo et un dessin de l'artefact original.
Il existe une très belle version moderne du calendrier Coligny ici, mais je voulais en créer un qui soit plus proche de l'original dans sa mise en forme, y compris les différentes notations aussi bien que possible reconstituées, même si on ne sait pas ce qu'elles signifient toutes. Mes seules sources protégées par le droit d'auteur sont Wikipédia et Skribbatous, et en obéissance aux termes de mes sources, mon calendrier est disponible sous licence CC-BY-NC-SA 4.0.
La date gauloise actuelle est:
(veuillez activer Javascript)
depuis l'unification des Gaules par Uercingetorixs.
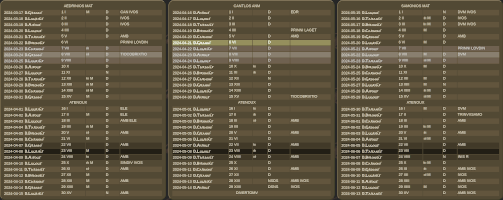
Le calendrier gaulois ne comporte pas de jours de la semaine, mais il est raisonnable, lorsqu'on parle du temps de nos jours, d'avoir des termes gaulois pour la semaine de sept jours. De nombreux dieux et déesses gaulois sont identifiés à des équivalents romains et germaniques, et de nos jours, les langues romanes et germaniques nomment leurs jours de la semaine d'après leurs dieux païens respectifs. Dans cet esprit, en plus des noms de jours de la semaine existants, je propose les noms gaulois suivants pour les jours de la semaine dans la colonne la plus à droite du tableau ci-dessous :
| nom anglais | divinité germanique | nom français | divinité romain | nom gaulois |
|---|---|---|---|---|
| Monday | Máni | lundi | Luna | dīus Lugriās |
| Tuesday | Týr/Tiw | mardi | Mars | dīus Aisous |
| Wednesday | Woden/Odin | mercredi | Mercurius | dīus Lugous |
| Thursday | Þórr | jeudi | Jupiter | dīus Taranēs |
| Friday | Freyja/Frigg | vendredi | Venus | dīus ꟈironiās |
| Saturday | (Njörꟈr) | samedi | Saturnus | dīus Carnonī |
| Sunday | Sól/Sunna | dimanche | (Sol) | dīus Granni |
Les salutations courantes incluent :
Chacun des éléments ci-dessus peut être suivi par :
*L'utilisation des formes tū en gaulois n'est pas spécifique aux personnes que vous connaissez bien. Le gaulois n'a pas la distinction T-V que possède le français, il serait donc parfaitement normal d'appeler un inconnu tū mais très étrange d'appeler une seule personne suīs (« vous »).
Pour remercier, vous pouvez utiliser le terme brātū. Ceci signifie litteralment "en remerciement". Si vous vous adressez à une seule personne, vous pouvez aussi dire brātun tei, ou si vous vous adressez à plusieurs personnes, brātun umē. Toutes ces expressions signifient « merci ».
L'équivalent le plus proche de « s'il te/vous plaît » serait mā eꟈꟈid ton tolistos, ou mā tolistos pour faire court. Cela signifie en réalité « si telle est ta volonté », ce qui rappelle les manières de formuler des demandes polies dans des langues apparentées. Cependant, ces deux expressions auraient pu paraître trop formelles ou désuètes dans les dernières versions du gaulois, il est donc plus courant de tout laisser tomber sauf le mā et le faire suivre de la forme d'un verbe qui, autrement, constitue un ordre. La plupart du temps, il s'agit de la forme du dictionnaire, mais sans la terminaison et avec un e final ajouté si nécessaire. e.g.
Pour dire au revoir, vous pouvez dire suauelon, littéralement « bon vent », comme dans « qu'un bon vent vous guide », ou po suessis, qui signifie quelque chose comme « jusqu'à nous nous rencontrons à nouveau ». Si vous voudriez remercier, vous pouvez également combiner brātun tei avec slānon tei (ou umē, selon le cas) avant de dire au revoir.
Les invocations aux dieux et aux déesses se terminent par un ensemble spécifique de politesses : brātun tei, slānon tei, molātun tei, tēgū/tēgomos in tancē., signifiant « grâce à toi, santé à toi, louanges à toi, je/nous allons en paix ».
Pour exprimer le désir de quelque chose, vous pouvez utiliser les verbes cobrāiū, mendū, suantū, et uelōr de manière plus ou moins interchangeable. Chacun peut être utilisé de la manière suivante :
(Lorsqu'on utilise un nom verbal de cette façon, il prend l'accusatif, et l'objet de l'action désirée prend le génitif.)
Les quatre verbes signifient « vouloir », « souhaiter » ou « désirer », mais il existe des nuances de sens :
Deux des verbes possèdent les terminaisons personnelles les plus courantes. Dans ce système, la première et la deuxième personne sont simples :
À la troisième personne, les terminaisons restent les mêmes, mais si un pronom est suffixé, il reflète le genre de celui qui désire quelque chose :
Ceci est également vrai pour le pluriel, mais comme dans la plupart des langues européennes, le pluriel masculin est utilisé pour les groupes mixtes :
Les terminaisons de cobrāiū sont similaires :
À la troisième personne, le mot est cobrāt (singulier) et cobrānt (pluriel). Les suffixes des pronoms sont identiques pour tous les verbes.
Les terminaisons de uelōr sont également différentes :
Ce mot appartient à une classe de verbes dont la voix active utilise les mêmes terminaisons que la plupart des verbes pour leur voix passive.
Voici quelques exemples de la manière de demander à quelqu’un s’il veut de l’eau :
Pour dire « j'aime [quelque chose] », il existe plusieurs possibilités. Vous pouvez dire « j'apprécie ___ » directement, avec un nom commun ou un nom verbal, ou dire « ___ me plaît ». Il existe cependant une différence grammaticale entre ces deux usages.
Commençons par la méthode la plus simple : dire « j'apprécie » avec un nom neutre. Ici, vous pouvez simplement prendre le mot pour « j'apprécie » et le faire suivre (ou précéder) de ce que vous aimez, comme chanter (cantlon), manger (depron), ou boire (oclon) :
Ajoutons le pronom mī à la fin du verbe parce que le verbe est au début de la phrase, et il n'y a aucun sujet nommé avant lui. Dans ces exemples, cantlon, depron, et oclon sont noms verbaux qui veulent dire "l'acte de manger" et "l'acte de boire", respectivement.
Rappelons que nous avons vu que nous pouvons utiliser différentes terminaisons personnelles pour le mot « vouloir ». Nous pouvons faire de même avec le mot « apprécier », et son paradigme est très similaire à celui des mots que nous avons déjà vus. Les terminaisons personnelles peuvent être utilisées ici pour préciser qui apprécie :
...et dans le pluriel...
Lorsqu'on utilise lubīt pour dire qu'on apprécie quelque chose, la chose appréciée est à l'accusatif. Ainsi, en utilisant les exemples de crisson (marcher), cīcos (viande), auuedenā (faire, performer), et aduēdon (raconter), on obtient :
Dans la dernière phrase, la chose aimée, aduēdon, est un nom verbal, signifiant littéralement « l'acte de raconter ». On dit donc « j'apprécie le récit d'histoires », et le mot pour « d'histoires » est spetlon. Il s'agit d'un génitif pluriel, et les génitifs pluriels se terminent toujours par -on. Ils sont donc faciles à confondre avec des noms neutres ou à l'accusatif.
Voici d'autres exemples utilisant d'autres mots avec des terminaisons similaires :
Voici quelques exemples supplémentaires :
Voyons maintenant l’autre façon de dire « j’aime » :
Jusqu'ici, ces phrases ressemblent beaucoup aux phrases lubiíū que nous avons déjà vues. Mais il y a une différence. Comme nous disons maintenant quelque chose « me plaît » au lieu de « j'apprécie », le sujet et l'objet ont échangé leurs places. Par conséquent, toutes les choses que nous aimons vont maintenant apparaître au nominatif :
Cela change également la façon dont nous exprimons qui est satisfait de la chose. Lorsque nous exprimions notre satisfaction par le verbe lubīt, nous pouvions dire que quelqu'un d'autre apprécie en changeant la terminaison du verbe. Mais maintenant, nous disons que la chose « plaît » à quelqu'un, nous conservons donc la même terminaison du verbe et modifions qui est satisfait comme suit :
...et dans le pluriel...
Après chaque verbe et son suffixe, il est possible d'ajouter soit l'accusatif d'un pronom personnel : moi, toi, elle, etc., soit un autre suffixe qui fonctionne comme complément d'objet du verbe.
Le nom verbal pour « plaire » est arueron, par exemple uelōr-mī ton arueron, « Je veux te plaire », une expression que vous pourriez adresser à votre patron, à votre professeur ou à vos parents. Le pronom ton est une des formes génitives de tū, « tu ». Si vous dites que quelqu'un vous plaît, cela signifie que vous appréciez son travail, ou ses efforts, ou même simplement que vous le trouvez serviable et/ou agréable. Vous pourriez dire arueriāt-sī-mī ou arueriāt-is-mī d'un(e) ami(e), d'un(e) parent(e), d'un(e) professeur(e), d'un(e) patron(ne), ou d'un(e) collègue.
Voici quelques exemples de personnes et de nombres supplémentaires pour vous entraîner. Remarquez les terminaisons des noms verbaux. L'ordre des mots est assez libre, ne vous en souciez pas trop. Cependant, les mots ci-dessous sont classés de la manière la plus courante pour chaque sens.
Utilisation des formes de lubīt with a person implies romantic or sexual interest. A stronger way to express that is with avec une personne implique un intérêt romantique ou sexuel. Une façon plus forte de l'exprimer est avec suantet.
Vous pouvez également exprimer votre affection pour une personne en utilisant carāt, ce qui signifie amour. Ce mot ne fait pas de distinction entre l'amour romantique, platonique, ou familial.
Toutes ces phrases peuvent être exprimées soit par des verbes à double suffixe, comme dans les exemples ci-dessus, soit par un pronom complément d'objet distinct. Par exemple, on pourrait tout aussi bien dire carāt-is sian. « il l'aime » (objet féminin) ou snāmus arueriāt-is-sian «la natation lui plaît» (objet féminin).
Il existe deux verbes signifiant « savoir, connaître », et il est important de les distinguer.
Tout d'abord, le verbe signifiant « découvrir », « apprendre à connaître » et son nom verbal.
Par conséquent, en gaulois, « j'ai découvert » et « je sais » sont identiques :
Deuxièmement, le verbe signifiant reconnaître, être familier avec, être familiarisé avec, et son nom verbal :
Le mot « entendre » est lié à « savoir », par le sens de « comprendre », comme nous le verrons bientôt. Le verbe « entendre » a deux conjugaisons : une active et une passive. La conjugaison active se rapproche davantage de « écouter », tandis que la passive se rapproche davantage de « cela vient aux oreilles ».
Les noms verbaux pour ces deux aspects de « entendre » sont cloustā (passif) et clouetus (actif).
Les deux conjugaisons de « entendre » égalment signifient « comprendre » :
Il existe également des verbes dédiés au sens de « comprendre » : peillāt (voir la conjugaison AI. dans les tableaux de verbes), avec des connotations de sens et de raison, tuodseget (conjugaison BI.), avec des connotations de découverte, et tanget (conjugaison BIII.) signifiant plus d'accord ou de relation.
puillā est le nom verbal de tuodseget.
Le mot pour « aller » est tēget. Voici quelques exemples de destinations possibles :
Dans les deux premières phrases, j'ai spécifié « pour acheter quelque chose » comme information contextuelle parce que magos signifie également plaine ouverte et duron signifie aussi porte.
Le nom verbal pour tēget est tixtā:
Le mot pour « venir » est ellat. Ce mot signifie plutôt « approcher », il peut donc avoir à la fois le sens de « venir » et « aller ».
Le nom verbal pour ellat est ellon:
Le futur de tēget est rigāset.
Pour pratiquer rigāset, voici quelques modes de déplacement :
Le futur de ellat est ellasiet.
Le passé de ellat est eialle:
En option, vous pouvez préfixer le passé avec ro-, par exemple ro-eialla-mī au magū « je vins du marché en plein air ».
Le passé de tēget est ludet:
Voici un exemple de conversation pour vous entraîner aux différentes formes de ces verbes, ainsi qu'aux différentes destinations et modes de transport. Vous pouvez cliquer sur les phrases une par une pour les entendre, puis répéter après chaque phrase. Ne vous préoccupez pas trop du ton, car il est très difficile à reconstituer et l'ordinateur n'est pas très performant pour sélectionner les tons appropriés aux significations. Mais cette activité développera la prononciation ainsi que la compréhension orale.
Ailleurs, deux amis organisent une visite.
C'est le lendemain et les invités sont arrivés.
Tout d’abord, voici les mots pour gauche et droite :


Deuxièmement, les directions de la boussole :
| toutos ⮙ |
||||
| ēron ⮘ | 🌍 | ⮚ uāri | ||
| ⮛ dexsiuos |
Les lecteurs attentifs remarqueront que « sud » et « droite » sont le même mot. En fait, le mot toutos signifie également « gauche » en plus de « nord ». Cela peut poser problème pour donner une direction, par exemple, si l'on doit uerte dexsiíū cela signifie-t-il « tourner à droite » ou « tourner vers le sud » ? Les langues celtiques insulaires ont chacune leurs propres solutions pour lever l'ambiguïté de ces directions, mais aucun système cohérent n'est évident que nous pourrions nous attendre à ce qu'ils partagent avec le gaulois. En revanche, lorsqu'on parle gaulois aujourd'hui, on peut créer les composés clīíolamā et dexsiuolamā pour « main gauche » et « main droite », respectivement, et les composés uīrotoutos et uīrodexsiuos pour « nord véritable » et « sud véritable ». On peut alors dire sans ambiguïté, par exemple : uerte dexsiuolamiā pour « tourner à droite ».
Notez également que les sons au début de « est » et « ouest » sont inversés en gaulois par rapport au français, c'est-à-dire que « ouest » commence par un E et « est » par un son OU.
Les mots uāri et ēron, ainsi que les composés se terminant par lamā, sont des noms ; les autres mots sont tous des adjectifs O/A.
Puisque l'onglet « Autres chiffres » regroupe une grande quantité d'informations, voici un aperçu simple du comptage en gaulois. Commençons par les nombres de un à dix :
Le chiffre 5 est parfois écrit « pimpe » au lieu de « pempe ». Les deux écritures sont totalement interchangeables et semblent indiquer que la prononciation serait identique ou presque.
Compter de onze à dix-neuf est plus facile que dans de nombreuses langues, car les nombres se terminent tous par decan:
Les nombres de un à quatre se déclinent en adjectifs qui s'accordent avec leur nom en nombre, en genre, et en cas, et précèdent généralement le nom, à moins qu'ils ne soient placés après lui pour mettre l'accent. Le nom peut alors prendre ses désinences habituelles. Les nombres de un à quatre se déclinent avec le nom. Le nombre un se décline comme un -os/ā adjectif. Voir l'onglet Nombres pour les déclinaisons de deux, trois et quatre.
Les nombres de cinq à dix-neuf sont indéclinables et sont accompagnés du génitif pluriel de la chose comptée, par exemple sextan dīuion « sept jours », littéralement « sept des jours ».
Le mot gaulois pour vingt est uicantī, qui fonctionne grammaticalement comme un nom féminin avec l'ensemble complet des cas au singulier, au duel, et au pluriel. En gaulois, on ne dit pas « vingt choses », mais « une vingt des choses ». Plus précisément, le mot uicantī devient le nom principal, et tout ce qu'il y a de vingt va au génitif pluriel. Les nombres 30 et plus se comportent de la même manière, par exemple ludū-mī trīcontīn leucānon « J'ai voyagé 30 miles », littéralement « j'ai allé un trente des miles ». Voici les manières les plus courantes de dire 20 à 90 :
Notre habitude de prononcer 80 comme quatre vingt vient en fait du gaulois. Dans ce système optionnel, trente est uicantī decan littéralement vingt-dix ; quarante est duī uicantī littéralement deux vingt (avec terminaisons duelles) ; cinquante est duī uicantī decan ; soixante est tidres uicantiās avec terminaisons plurielles ; quatre-vingts est petedres uicantiās ; et quatre-vingt-dix est petedres uicantiās decan. Mais les chiffres -contī étaient plus couramment utilisés que le système de comptage par vingtaine.
Cent c'est canton. Les nombres de deux cents à neuf cents ressemblent à douze à dix-neuf, par exemple duocanton, etc.
Il n'existe pas de mot attesté pour mille, mais c'étaitest probablement quelque chose comme mīlle, un emprunt au latin, tout comme dans les langues celtiques modernes. Le terme reconstitué *gellon, qui est parfois utilisé, est très douteux et ne reflète probablement pas la réalité de la langue parlée par les anciens.
| dubus | cēros | lētos | blāros | uindos |
| giluos | dunnos | roudos | uebrus | melinos |
| glaꟈꟈos | bugios | gurmos* | argios | canecos |
*Le mot gurmos en gaulois désigne toute teinte foncée saturée. Il peut désigner le vert profond de feuilles saines ou la pigmentation d'une peau très foncée. Son usage est similaire à celui du terme « foncé comme le vin » (οἶνοψ) en grec ancien.
Des combinaisons des noms de couleurs de base sont possibles :
Avant de manger, mettons la table. Les Gaulois de l'Antiquité utilisaient des ustensiles de manger, même si leurs ustensiles n'étaient pas aussi standardisés que ceux d'aujourd'hui. Ils utilisaient des couteaux de toutes formes et de toutes tailles pour couper et piquer leurs aliments, et ils possédaient peut-être ou non des cuillères (c'est un sujet de débat parmi les historiens, mais le proto-celtique possède une racine reconstruite (lien en anglais) pour « cuillère » signifiant apparemment « chose que vous léchez »). Ils avaient également des serviettes en tissu pour emporter de la nourriture à la maison. Pour pouvoir utiliser le gaulois à l'époque moderne, nous allons mettre la table avec des ustensiles modernes.
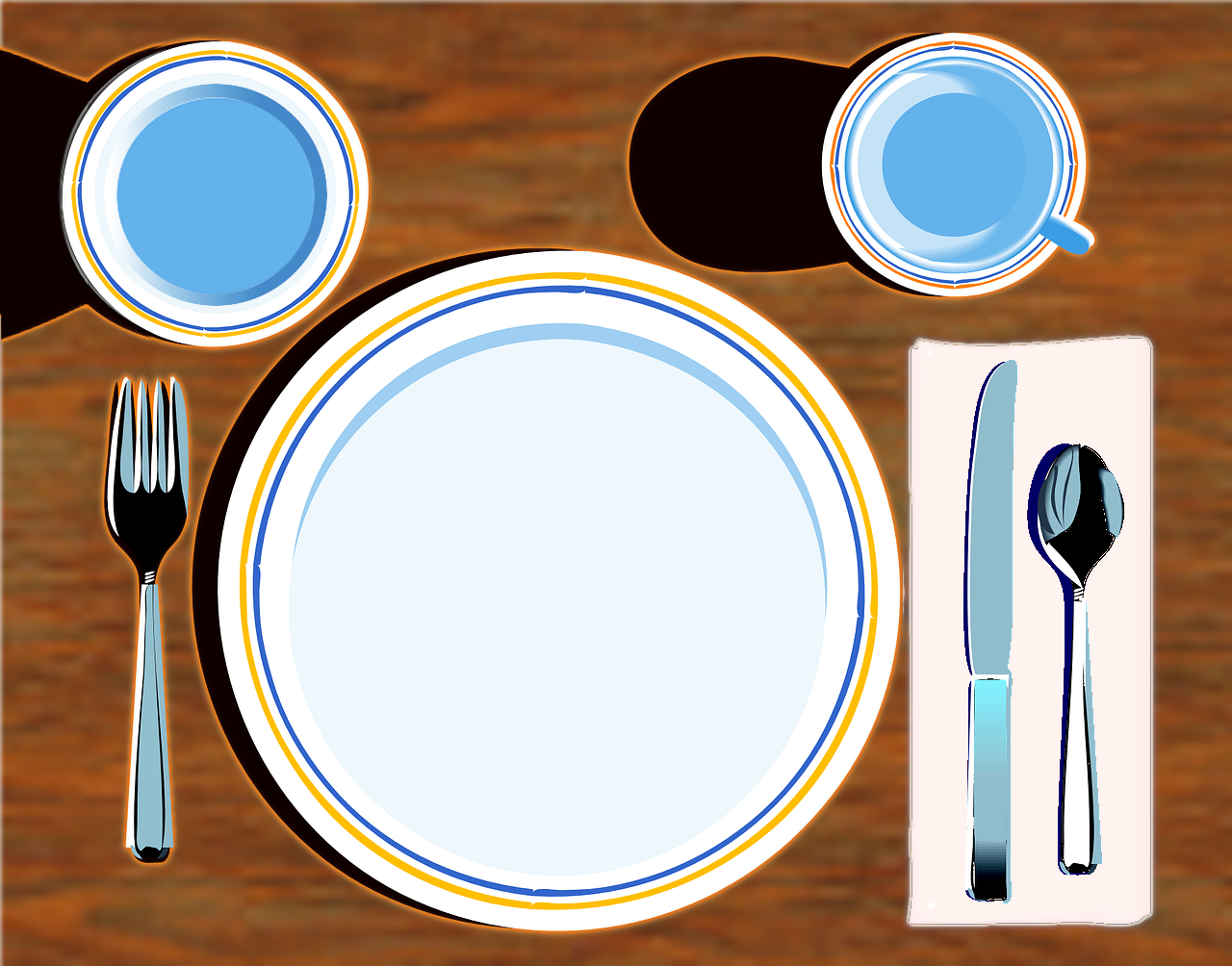 bracā
gabalos
scēnā
lēgā
platā
caucā
annā
bracā
gabalos
scēnā
lēgā
platā
caucā
annā
Une façon de dire « manger » est depret. Son nom verbal est depron. Voici une conversation pour s'entraîner en cliquant sur les phrases pour les entendre prononcées, puis en répétant après chacune d'elles :
Un autre mot moins courant pour « manger » est edet. Historiquement, edet était le mot original pour « manger ». Cependant, en gaulois, son usage a été diminué au profit de depret. De plus, edet a obtenu son nom verbal itiā, qui signifie également repas, en raison d'une confusion avec une racine sans rapport, et pourrait également être influencé par ibet (« boire » ; voir ci-dessous). Le futur de edet est eꟈꟈiet, et le passé est āde.
Le verbe pour « boire » est ibet.
Le verbe ibet possède également un nom verbal irrégulier : oclon qui signifie également boisson. Le mot oclon ne fait pas de distinction entre les boissons alcoolisées et non alcoolisées.
Voici quelques termes utiles relatifs à la nourriture et aux boissons en général :
En particulier, le nom biíaton forme plusieurs composés pour les types d'aliments et articles liés à l'alimentation :
Termes relatifs aux céréales, aux grains et aux produits cuits au four ou frits :
Termes relatifs à la viande et aux produits laitiers, y compris les différents types de viande :
Termes relatifs aux fruits, aux baies et aux noix :
Termes relatifs aux boissons, avec et sans alcool :
Le terme ceruēsiā pour « bière » est un terme gallo-latin tardif, dérivé du mot curmi, qui est devenu le mot usuel pour « bière » dans certaines langues romanes (en français, il a été remplacé par un mot germanique, apparenté à l'anglais « beer »).
Les mots pour les unités de temps incluent :
Les anciens Gaulois n'avaient probablement pas de mot pour « minute ». Il est donc raisonnable de supposer que le mot serait emprunté au latin, soit de minūta comme dans les langues brittoniques, soit de mōmentum comme en gaïdélisme. Ici, j'ai supposé la première hypothèse. Le sens de « seconde » est plus complexe. En gallois, on peut dire « seconde » par « clin d'œil », en utilisant un terme apparenté à abranꟈ « paupière ». En gaélique, on l'appelle « tic » (diog), et en irlandais, il est directement emprunté à l'anglais. Le gallois le calque également du latin secundus, en utilisant l'ordinal « 2e » suivi d'un suffixe, tout comme le breton et le cornique. Comme il s'agit de la situation la plus courante, j'ai extrapolé la même chose pour le gaulois.
Phrases :
Pour répondre à la question « quelle heure est-il », il est nécessaire d'abord avoir quelques mots de vocabulaire pour les moments de la journée :
Phrases :
Le mot noxs est un nom irrégulier féminin de radical noxt-, tout comme ses composés arenoxs, comnoxs, et santeronoxs. Le mot uāri est neutre, et les autres noms de temps de la journée sont tous masculins.
Quelques moments précis :
Les temps ci-dessus sont donnés dans le cas instrumental, à l'exception de gdes qui est un adverbe, car ce sont des moments où quelque chose se produit.
Les anciens Gaulois divisaient l'année en deux parties plus ou moins égales : l'été et l'hiver. Ils divisaient chaque mois en deux parties, la limite entre elles étant appelée atenouxs, signifiant renouvellement. Ils divisaient le cycle circadien en jour et nuit. Les jours du mois étaient comptés de 1 à 15, puis, après Atenoux, le compte était remis à 1 et courait jusqu'à la fin du mois. Ainsi, si les Gaulois utilisaient les heures, ils auraient trouvé une horloge de 12 heures plus naturelle, puisqu'elle se remet à 1 après midi. Comme le jour commençait au coucher du soleil (ou à 18 h 00 heure locale), je propose d'appeler cela la première heure de la nuit. Les heures de la nuit peuvent alors compter jusqu'à 12, heure jusqu'à laquelle le soleil se lève (ou l'heure atteint 6 h 00) démarrant la première heure du jour.
Voici une conversation à écouter et à répéter après chaque phrase, pour s'entraîner à dire l'heure :
Voici la liste complète des heures proposées de la journée à titre de référence et pour montrer le modèle qu'elles forment :
En option, les quatre premières heures de la journée, de 6 h 00 à 9 h 59, peuvent être exprimées en heures « du matin », c'est-à-dire cintuxsā ōrā bāregū à petuariā ōrā bāregū, et les quatre dernières heures de la journée, de 14h00 à 17h59, peuvent être exprimées en heures « de l'après-midi », nametā ōrā areuesprū à duodecametā ōrā areuesprū. Cette subdivision des heures de jour en trois parties égales se reflète dans le calendrier, où les marques triples sont censées indiquer une importance particulière pour une ou deux des subdivisions les jours où ces marques sont inscrites.
Le Nouvel An gaulois a lieu en mai ou juin, lorsque le temps se réchauffe. Cette période, appelée cintusamonios, littéralement « le premier de l'été », est considérée comme le début de l'été, et à l'époque classique, une fête y était organisée. Les fêtes marquaient également les autres changements de saison, ainsi qu'à d'autres moments de l'année. Les quatre saisons sont :
Le calendrier divise l'année en deux saisons : la saison Samonios,
qui comprend l'été et l'automne, et la saison Giamonios, qui comprend l'hiver et le printemps.
Les noms des mois sont connus grâce au calendrier de Coligny et sont attestés comme suit :
Samonios,
Dumannios,
Riuros,
Anaganntios,
Ogronios,
Cutios,
Giamonios,
Simiuisonnā,
Equos,
Elembiuos,
Aedrinios,
Cantlos.
La plupart des paires de mois semblent contraster d’une manière ou d’une autre ;
Le mot gaulois pour « temps », ayant à la fois le sens chronologique et météorologique, est amman. Un autre mot pour « météo » est sīnā. Voici quelques mots de vocabulaire et quelques expressions pour décrire la météo :
Notez que les adjectifs ꟈirācon et snoudiniācon sont au neutre. C'est la même manière impersonnelle que nous disons en français « il fait beau » ou « il fait mauvais temps », mais avec « être » en lieu de « faire », sans que « il » doive désigner une entité spécifique. Ceci est en contraste avec des noms comme reusos, tartos, et uintos qui sont exprimés comme des choses qui existent plutôt que comme des attributs du temps. La terminaison -i sur le verbe est un espace réservé dénué de sens et n'est spécifique à aucun genre grammatical. L'il-impersonnel est également utilisé avec les adjectifs suivants pour décrire la température :
L'adjectif conteꟈꟈos / conteꟈꟈā peut également décrire une personne chaleureuse, amicale, agréable.
Voici un exemple de conversation où deux amis vivant sous des climats différents discutent au téléphone de la météo :
Les températures, en termes de niveau de confort, sont exprimées de manière similaire à celle du français, par exemple :
*ougron est un adjectif neutre et un nom, tous deux signifiant « froid ». Comme il est neutre, le nominatif se termine par -on.
Phrases utiles :
Liste des professions, par catégorie :
Plusieurs noms de professions se terminent par -uiros (homme). Malheureusement, on ignore la forme féminine de ces mots. En voici quelques-uns :
Il n'est pas déraisonnable de néologiser ces termes en remplaçant -uiros par le terme plus inclusif -donios/ā. On peut ainsi dire :
rigāset est le futur de tēget. Notez également le futur de la première personne du mot appiset qui signifie « voir ».
Dans le dernier exemple, le nom collectif regeniā apparaît avec un pronom au pluriel et un verbe au pluriel.
Voici une conversation pratique répétée sur l’étude des langues :
Le mot de base pour ami(e) est caranꟈ. Cependant, d'autres mots peuvent désigner un ami, un voisin, un compagnon, voire un partenaire amoureux ou un conjoint. Le gaulois ne fait pas toujours la distinction entre platonique et romantique, et certains mots brouillent donc cette frontière.
Il existe cependant un adjectif comprinnos attesté dans le contexte spécifique d'un contrat de mariage, avec le sens de « unis par les liens du mariage », donc si vous présentez quelqu'un comme votre comprinnos/ā, vous l'identifiez spécifiquement comme votre conjoint.
Les termes de parenté sont plus clairement définis. Commençons par les termes relatifs à la famille immédiate :
Et les termes de la famille élargie :
* Soyez prudent avec les terminaisons de cas ; l'ordre des mots est objet-verbe-sujet, littéralement « à ma grand-mère il y a une maladie », etc. Cela signifie que le mot après eꟈꟈi ne changera pas selon le genre de la personne, mais le mot pour la personne qui souffre sera au datif.